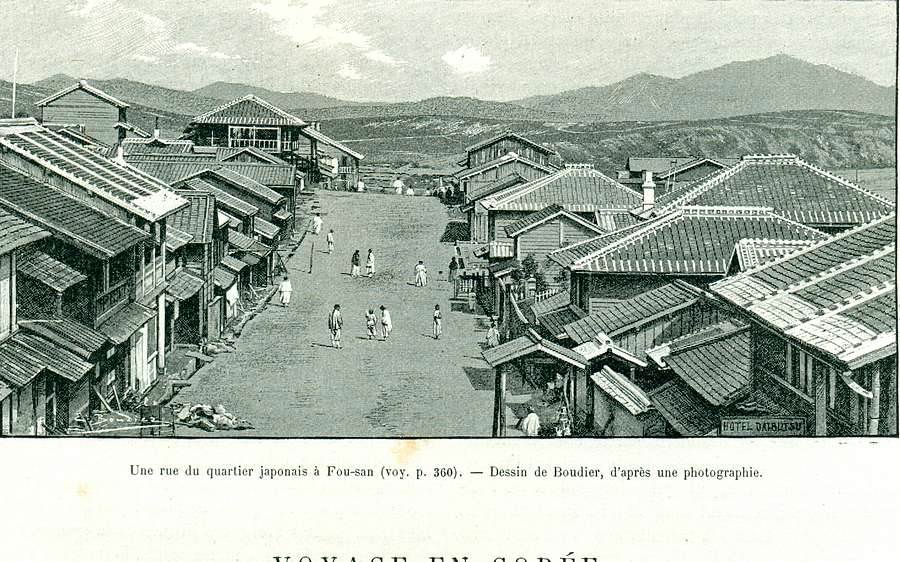
Voyage
en Corée
par
Charles Varat
Explorateur chargé de mission ethnographique
par le ministère de l'Instruction publique
1888-1889 — texte et dessins inédits
Le Tour du
Monde LXIII, 1892 Premier Semestre.
Paris : Librairie Hachette et Cie.
Pages 289-368
Section V. [Click here for
the other sections: Section I,
Section II,
Section III,
Section IV.]
Gravures (all)
[Click here for the English
translation: Section
One; Section
Two; Section
Three; Section
Four; Section
Five.] Enravings
(all)
Un menu
coréen. - Esthétique. - Les chiens et les chats. -
Départ de Mil-yang. - Vallées et rizières. -
Hommages à la vieillesse. - Coréens et Japonais. -
Paysages aquatiques. - Le Tchung-ka-rnœ-san. -A
l’hôtel japonais. -Adieux de ma caravane. -
Comment fument les mousmés. - Mandarins, Européens
et Japonais. - Les quatre Fou-san. - Navigation
sur la côte orientale. - Gen-san et Tok-ouen. -
Les tigres. - Vladivostok. - Les Coréens en
Sibérie. - Un typhon dans le détroit de Corée. -
Nagasaki. - Conclusion.
Nous nous
installons à l’auberge, et comme Mil-yang est le
chef-lieu d’un district important, je fais
parvenir immédiatement ma carte coréenne au
mandarin qui l’administre et j’apprends bientôt
que ce fonctionnaire est absent par le noble
gentilhomme qui le remplace et vient me faire
visite. Je lui offre une collation européenne;
elle paraît fort de son goût, car il y fait
honneur, me remercie vivement, et s’excuse de ne
pas me recevoir chez lui, son père étant malade.
Le soir même il m’envoie un excellent dîner
coréen, servi dans des vases en faïence de grand
prix. En voici le menu: une soupe grasse au
froment, des poissons marinés, du taureau coupé en
tranches minuscules et ovales, du poulet également
dépecé, du gibier de même etc. Le tout est
accompagné de navets cuits, d’une salade de
poireaux mélangée d’un agréable liquide jaune; de
plus, pour l’assaisonnement des autres plats, une
sauce aux haricots, exquise comme celle qu’on
fabrique au Japon, et un petit bol contenant un
délicieux coulis qu’on me dit être chinois. Le
repas est complété par des gâteaux appétissants,
de fines sucreries, des fruits: pommes, poires,
kaki, etc.; enfin, pour arroser le tout, une
bouteille en porcelaine fort élégante remplie d’un
délicieux vin de riz, semblable à celui que m’a
offert le gouverneur de Taïkou, Le vin coréen,
rouge ou blanc, est extrait du riz, du froment,
etc., et a une jolie transparence, obtenue en y
jetant un charbon embrasé au moment du moût. Il
est infiniment supérieur à celui qu’on fabrique en
Chine et au Japon, et rappelle absolument notre
vin de raisin, avec je ne sais quel velouté d’une
finesse étrange qui flatte le palais. Quoiqu’il
soit très alcoolisé, je le trouve si excellent que
je veux en faire venir en France pour mes amis,
mais je dois y renoncer, car il se conserve très
peu de temps, et n’est pas transportable. Ce
luxueux repas coréen est accompagné d’un immense
bol de riz bouilli qui remplace ici le pain; l’eau
que l’on en retire est la boisson ordinaire, le
thé étant un extra pour la plupart des Coréens.
J’avoue que, malgré toute la science culinaire
qu’on a déployée pour moi, je préfère effet
d’habitude d’estomac un simple bifteck aux pommes
à ce repas mandarinal, en ajoutant pourtant
qu’entre les savantes cuisines chinoise, japonaise
et coréenne, je préfère cette dernière. Le soir
même j’envoie ma carte de remerciements au noble
coréen qui a répondu d’une si aimable façon à ma
collation européenne, et j’offre les reliefs de
mon repas à mes deux soldats. Ceux-ci m’assurent
n’avoir jamais rien mangé de meilleur de leur vie;
je les congédie et ferme la porte de ma chambre.
Mon ameublement est augmenté d’un
petit paravent coréen haut de 1 mètre sur 3, que
j’ai acheté en route; il est fort ancien et se
compose de huit panneaux; chacun d’eux porte le
caractère chinois d’une vertu que l’homme doit
pratiquer: piété filiale, ghai;
déférence, tche;
fidélité, tchoug;
confiance, tching
politesse, rey;
probité; ry;
désintéressement, vom;
modestie, tchy:
ces qualités sont figurées de plus, suivant
l’usage, par des animaux ou objets symboliques
dont les brillantes couleurs illuminent mon
réduit. Pendant qu’au dehors la pluie tombe à
torrents avec une continuité inquiétante, je
cherche l’oubli en admirant mon écran, qui, outre
toutes les vertus qu’il souhaite à son
propriétaire, présente, en effet, au point de vue
artistique, de précieux renseignements sur les
origines de l’art coréen. Précisons: un petit
cadre violet bordé de blanc entoure chaque
feuille, excepté à la partie inférieure, qui se
termine par une large bande noire bordée d’une
autre blanche, sur laquelle court un fin dessin
géométrique bleuté. Même répétition à la partie
supérieure où vient s’ajouter une étroite bande
noire soulignée d’un trait rouge viné, qui
circonscrit tout le panneau. Celui-ci, d’un blanc
paille, est surchargé de grands caractères chinois
archaïques faits largement et d’un rare mérite
calligraphique; ils s’enlèvent vigoureusement en
encre noir sur le fond clair où se trouvent peints
au-dessous ou autour d’eux en couleurs très pâles
les attributs allégoriques de chacun de ces
signes. Malgré le choc de tons aussi contrastants,
une véritable harmonie s’en dégage, grâce à
l’appui des larges bandes noires du cadre. Quant
aux attributs, outre la délicatesse de leurs
nuances, ils se caractérisent par l’hiératisme de
leurs lignes, et l’on retrouve dans la figuration
des fleurs et même des animaux symboliques le
dessin tout à la fois géométrique et vague des
produits artistiques de la Perse et des Indes.
Telles sont les sources primitives dont les
Coréens ont su dégager un véritable art national.
Nous l’avions constaté déjà en admirant la superbe
ordonnance des palais et des principaux monuments
de Séoul, les peintures des pavillons des portes
de Taïkou, les merveilleux costumes de la cour du
gouverneur, les sculptures et l’architecture si
pittoresques de Mil-yang, enfin toutes les
productions manuelles et même le théâtre
monologuiste, si vivant, si humain, si personnel.
Là-dessus je souffle ma bougie et m’endors en
souriant à la pensée qu’on m’avait représenté ces
aimables Coréens comme de véritables sauvages.
Le lendemain matin, je me lève de
très bonne heure et guette une embellie pour
photographier les principaux monuments et les
aspects si curieux de Mil-yang. Après deux heures
d’attente je puis enfin sortir et commencer à
opérer, au grand ébahissement d’une partie de la
population, que mes deux soldats maintiennent à la
distance nécessaire de mon objectif. Un chien de
taille moyenne, au poil jaunâtre et aux yeux
verts, comme ils sont souvent ici, me suit
partout, car je l’ai caressé, ce que ne font
jamais les Coréens. Je crois avoir trouvé la
raison de cette répulsion bizarre chez des gens
qui aiment les animaux: elle provient de ce qu’un
certain nombre d’enfants courant nus à travers la
campagne ont été mutilés par les chiens. Aussi,
pour éviter la fréquence de ces accidents,
habitue-t-on les petits garçons à leur jeter des
pierres, ce qui fait que plus tard, étant devenus
hommes, ils chassent et rudoient ces malheureux
quadru-pèdes. Ceux-ci, repoussés de tous et vivant
à demi sauvages, voient augmenter encore
l’aversion profonde qu’ils inspirent par les
innombrables teks,
petites araignées brunes de la grosseur d’un pois,
qui, armées de courtes pattes, fourragent à l’envi
dans leur fourrure mal entretenue. Ils n’en
restent pas moins fort intelligents, et à Séoul
savent très bien ouvrir eux-mêmes la petite
chatière qu’on leur ménage au bas de chaque porte
et dans le volet qui en double la fermeture de
nuit. Cela leur permet de rentrer à toutes heures
et d’échapper ainsi aux gourdins des Coréens, qui,
comme les Chinois, apprécient surtout cet animal
sous la forme de ragoût et particulièrement de
côtelette.
Mais il est temps de partir: nous
nous éloignons, réchauffés par le soleil, dégagé
enfin des nuages qui interceptaient ses rayons.
Toute la campagne rafraîchie étincelle de mille
feux, illuminant autour de nous bouquets d’arbres,
fermes et champs admirablement cultivés. Je me
retourne et, jetant un dernier regard sur les
murailles de Mil-yang, j’y retrouve les traces de
maints combats autrefois soutenus contre les
Japonais. Comme les bandes d’oiseaux que nous
rencontrons souvent se dirigeant vers le sud-est,
les envahisseurs durent aussi fuir, non devant la
rigueur du climat, mais en face de tout un peuple
se levant pour reconquérir son indépendance.
Puissions-nous voir un jour s’effectuer chez nous
une pareille migration!
Après avoir quitté Ori-tchang et
passé le Sain-tang et le Koufa, affluent du
Nak-tong-yang, nous nous éloignons du fleuve et
nous traversons plusieurs villages importants,
notamment Tang-yori-tchou, à l’entrée desquels
nous rencontrons souvent des chapelles votives
élevées en l’honneur de ceux ou de celles qui se
sont distingués par le patriotisme, la piété
filiale, l’accomplissement de leurs devoirs
paternels, maternels ou fraternels, et même aux
veuves dont la vertu a été l’honneur de leur sexe:
glorieux édicules destinés à exalter dans tous les
cœurs les vertus familiales, base de la société
coréenne. Nous sommes maintenant dans une vaste
plaine, bornée au loin par une chaîne de collines;
les rizières qui nous environnent forment un
immense damier où de nombreux travailleurs,
plongés dans l’eau jusqu’aux genoux, se livrent à
leur dur labeur. La curiosité excitée par mon
passage suspend à peine un instant leur travail,
qu’ils reprennent aussitôt tant est actif le
paysan coréen. De temps à autre le soldat qui est
en tête demande le chemin ou plutôt quelle est
celle des petites crêtes émergeant des rizières
qu’il faut suivre, et de loin notre caravane a
l’air de marcher sur les eaux. Chacun s’empresse
de nous renseigner de la voix, mais surtout du
geste, car depuis que nous avons quitté Taïkou et
avançons vers le sud, on comprend de moins en
moins le langage de mes hommes, par suite du
changement de plus en plus accentué de dialecte.
Voici que vient vers nous un grand et
magnifique vieillard, il marche solennellement,
s’appuyant sur le long bâton très bien tra-vaillé
qu’on appelle en Corée «canne de vieillesse». A
l’approche de l’ancêtre, chacun, pour laisser
libre l’étroit chemin qu’il suit, entre sans
hésiter à mi-jambes dans la rizière et le salue
respectueusement; moi-même je lance mon cheval
dans l’eau, heureux, en suivant leur exemple, de
rendre ainsi mon hommage européen à la majesté des
ans. La vieillesse est une royauté doublement
sacrée en Corée, car si l’aïeul a droit à la piété
filiale de chacun, il doit aussi être pour tous et
particulièrement pour les siens un vrai père; si
quelque égoïste y manque, le mandarin sait le
rappeler à la vertu, sans pour cela manquer au
respect dû au grand âge. J’en reproduit ici un
curieux exemple: «Dernièrement, écrivait en 1855
Mgr Daveluy, un jeune homme de plus de vingt ans
fut traduit devant un mandarin pour quelques
francs de cote personnelle dus au fisc et qu’il se
trouvait dans l’impossibilité de payer. Le
magistrat, prévenu d’avance, arrangea l’affaire
d’une manière qui fut fort applaudie. «Pourquoi
n’acquittes-tu pas tes contributions? demande-t-il
au jeune homme. –Je vis difficilement de mes
journées de travail, et je n’ai aucune ressource.
–Où demeures-tu? –Dans la rue. –Et tes parents?
–Je les ai perdus dès mon enfance. –Ne reste-t-il
personne de ta famille? –J’ai un oncle qui demeure
dans telle rue, et vit d’un petit fonds de terre
qu’il possède. –Ne vient-il pas à ton aide?
–Quelquefois, mais il a lui-même des charges, il
ne peut faire que bien peu pour moi». Le mandarin,
sachant que le jeune homme parlait ainsi par
respect pour son oncle, et qu’en réalité celui-ci
était un vieil avare fort à son aise qui
abandonnait le pauvre orphelin, continua de le
questionner. «Pourquoi à ton âge n’es-tu pas
encore marié? –Est-ce donc si facile? qui voudrait
donner sa fille à un jeune homme sans parents et
dans la misère? –Désespères-tu de te marier? –Ce
n’est pas l’envie qui me manque, mais je n’en ai
pas les moyens. –Eh bien, je m’en occuperai; tu me
parais un honnête garçon et j’espère en venir à
bout; avise au moyen de payer la petite somme que
tu dois au gouvernement et dans quelque temps je
te ferai rappeler». Le jeune homme se retira sans
trop savoir ce que cela signifiait. Le bruit de ce
qui s’était passé en plein tribunal arriva aux
oreilles de l’oncle, qui, honteux de sa conduite
et craignant quelque affront public de la part du
mandarin, n’eut rien de plus pressé que de faire
des démarches pour marier son neveu. L’affaire fut
rapidement conclue, et l’on fixa le jour de la
cérémonie. La veille même, lorsqu’on venait de
relever les cheveux du futur époux, le mandarin,
qui se faisait tenir au courant de tout, le
rappelle au tribunal et lui réclame l’argent de
l’impôt. «Eh quoi, dit le mandarin, tu as les
cheveux relevés; es-tu déjà marié? Comment as-tu
fait pour réussir si vite? –On a trouvé pour moi
un parti convenable, et mon oncle ayant pu me
donner quelques secours, les choses sont conclues:
je me marie demain. Très bien, mais comment
vivras-tu? as-tu une maison? –Je ne cherche pas à
prévoir les choses de si loin, je me marie
d’abord, ensuite j’aviserai. Mais en attendant, où
logeras-tu ta femme? Je trouverai bien chez mon
oncle ou ailleurs un petit coin pour la caser en
attendant que j’aie une maison à moi. Et si
j’avais le moyen de t’en faire avoir une? Vous
êtes trop bon de penser à moi, cela s’arrangera
peu à peu. Mais enfin, combien faudrait-il pour te
loger et t’établir convenablement? –Ce n’est pas
petite affaire, il me faudrait une maison,
quelques meubles et un petit coin de terre à
cultiver. 200 nhiangs (environ 400 fr.) te
suffiraient-ils? –Je crois qu’avec 200 nhiangs je
pourrais m’en tirer très convenablement. –Et bien,
j’y songerai; marie-toi, fais bon ménage et sois
plus exact désormais à payer tes impôts». Chaque
mot de cette conversation fut répété à l’oncle; il
vit qu’il fallait s’exécuter sous peine de devenir
la fable de toute la ville, et quelques jours
après ses noces le neveu eut à sa disposition une
maison, des meubles et les 200 nhiangs dont avait
parlé le mandarin». Connaissez-vous, lecteur, un
autre pays où les devoirs de la famille soient
tellement bien compris de tous qu’il suffise à la
justice, quand quelqu’un les oublie, d’en paraître
informée pour que l’ordre soit aussitôt rétabli?
Bientôt nous sortons des rizières
pour nous rapprocher des collines par un semblant
de route que suivent de nombreux Coréens. C’est
ainsi que, nous rapprochant de la mer, un
mouvement de vie humaine de plus en plus accentué
succède à notre isolement presque complet dans la
montagne. Dans les villages où nous passons
maintenant, tous les instruments agricoles servant
à préparer le riz sont en mouvement. La fiévreuse
activité qui règne dans ce canton provient de ce
que ses habitants, ayant échappé seuls à la
sécheresse, s’efforcent de venir en aide au pays
voisin, où bientôt la famine s’étendra dans toute
son horreur. Nous atteignons enfin la route
directe de Séoul à Fou-san, où se dressent devant
moi, à mon grand ébahissement, les poteaux du
télégraphe récemment établi en Corée, comme au
Japon et en Chine. De temps à autre nous
rencontrons quelques marchands japonais de Fou-san
venus ici pour leurs affaires. Ces petits hommes,
en général fort laids, avec leurs longues robes à
large ceinture, leurs bottines du Pont-Neuf et
leurs petits melons de la Belle-Jardinière, me
font un étrange effet au milieu de cette
population grande et forte au costume si
personnel. Il me semble qu’avant peu nous verrons
que les Coréens ne le cèdent en rien à leurs
voisins dans la voie du progrès. En effet, si des
Japonais, dont ils ont été les éducateurs, les
surpassent aujourd’hui au point de vue de
l’industrie et des arts, les Coréens les
rattraperont bientôt pour les dépasser, grâce à
leur supériorité morale. Elle est attestée chez
eux par leur admirable organisation de la famille,
leur solidarité, leur énergie au travail, enfin
les étonnants progrès qu’ils ont faits en quelques
années, comme le prouve le télégraphe, dont les
lignes civilisatrices s’étendront bientôt sur
toute la Corée.
Nous sommes entourés maintenant de
charmantes collines, d’où s’échappent cent cours
d’eau qui se répandent dans la vallée, où ils
forment un paysage des plus aquatiques; aussi ne
faisons nous que franchir à gué une multitude de
petites rivières, où mon cheval manque un moment
se noyer. Nous nous arrêtons pour déjeuner à
Sang-san-natri, dans une auberge située à
l’extrémité d’un village et tout proche d’un large
ruisseau au bord duquel quelques paysannes lavent
leur linge, ce qui n’est pas une petite affaire,
vu les nombreux dessous des Coréennes et l’usage
des costumes blancs portées par presque tous les
hommes. Aussi tous ces vêtements, étendus à terre
pour sécher au soleil, nous donnent-ils au premier
aspect la sensation d’un champ couvert de neige se
détachant au milieu d’un paysage verdoyant; c’est
charmant, vu de la fenêtre de la chambre où je
prends mon repas.
Nos chevaux sont à peine rassasiés
que je hâte le départ, pour arriver le soir même à
Fou-san, et je fais bien, car, après avoir franchi
une suite de collines, nous arrivons un peu avant
la nuit devant un col assez élevé, le
Tchung-ka-moe, qui se dresse droit devant nous.
L’ascension en est d’autant plus difficile qu’il
n’existe pas de chemin au milieu des rochers
informes qui obstruent notre marche. Je ne pouvais
terminer par une passe plus pénible. Deux fois la
caravane arrive à pic au bord d’un effroyable
abîme, qui dans l’obscurité eût été notre perte.
Nous dominons maintenant à demi la profonde
vallée, au-dessus de laquelle d’énormes rochers
suspendus semblent à tout moment prêts à se
détacher pour écraser de leur sombre masse le
petit village qui s’étend au fond de la vallée, où
mugit à travers les rochers un torrent écumeux. Le
soleil couchant illumine ce superbe décor d’opéra
des tons les plus heurtés: c’est splendide.
Bientôt, noyés dans les derniers feux du jour,
nous atteignons enfin le sommet désiré et
jouissons brusquement, de l’autre côté de la
montagne, d’une nuit parsemée d’étoiles. La
descente s’opère lentement par une véritable
route, où nous précède un habitant du pays que, vu
l’obscurité, j’ai pris pour guide. Nous atteignons
la plaine pour arriver enfin à un mamelon boisé
contourné par une allée de cèdres magnifiques qui,
par une pente rapide, conduit à l’entrée de
Fou-san. Là, impossible de se faire comprendre,
car le dialecte de la côte orientale devient
complètement différent de la langue généralement
parlée en Corée. Aussi, dans l’embarras général,
tous mes hommes se réunissent autour de moi et
prétendent qu’ayant su voyager dans leur pays que
je ne connaissais pas, je dois faire de même dans
celui-ci. Le cas est assez général, car notre
guide affirme qu’il n’y a pas d’auberge à Fou-san.
Dans l’impossibilité d’obtenir de lui, vu son
patois aucun autre renseignement, c’est avec la
plus grande difficulté, qu’aidé de mon interprète,
je puis lui donner l’ordre de nous conduire à la
concession étrangère. Je pénètre à sa suite dans
la ville, et arrive enfin au bureau de police
japonais, où se trouve un très aimable employé,
avec lequel, grâce aux caractères chinois, on peut
enfin s’entendre. Il m’indique un hôtel japonais
où je pourrai m’installer avec mes bagages; mais
la caravane devra, à cause des chevaux, chercher
un gîte à 5 kilomètres de là, dans la ville
coréenne; quelques minutes plus tard, nous
arrivons à mon hôtel.
C’est le moment de solder mes gens,
qui avaient déjà reçu des comptes au départ de
Séoul et à Taïkou. Je complète donc la somme due,
ajoute une large gratification, doublée pour le
petit orphelin, qui, vu la saison, a absolument
besoin de vêtements chauds, et prie mes hommes de
bien vouloir le ramener avec eux pour l’arracher à
la famine. Ils me le promettent, se retirent en me
remerciant beaucoup, et je vois avec un véritable
sentiment de tristesse s’éloigner ces braves gens,
qui paraissent tout aussi chagrins que moi de
notre séparation. Vient alors le tour de mes deux
soldats et de mon cuisinier. Je leur propose de
rentrer à Séoul par la voie de mer ou par terre en
suivant la route directe de la poste, beaucoup
moins longue que celle que nous avons parcourue;
dans ce dernier cas, ils bénéficieront du prix de
leur transport, que je leur payerai. Mes soldats
acceptent avec empressement ma dernière
proposition. J’appris, depuis, leur heureuse
arrivée à Séoul plusieurs jours avant celle du
bateau qu’ils auraient dû attendre ici. Quant à
mon maître-queux, il hésite; mais, quelques heures
plus tard, ayant trouvé à se placer chez le consul
chinois de Fou-san, il vient toucher le prix de
son passage, qui est pour lui tout bénéfice. Reste
mon interprète; celui-ci, homme peu curieux des
choses de ce monde, mais bon père de famille,
refuse le voyage que je lui ai offert de faire
avec moi à l’étranger, il préfère en toucher le
montant et rentrer parmi les siens. Toutes ces
questions réglées, je rentre dans ma chambre, très
affecté de tous ces adieux; cela se voit tellement
sur mon visage, que les deux petites mousmés qui
m’attendent pour me servir mon dîner en sont
toutes décontenancées: on est si rarement triste
quand on arrive dans un hôtel japonais!
Nous avons traversé complètement le
Kyeng-syang-to: disons donc quelques mots de cette
magnifique province. Elle est bornée au nord par
le Kang-ouen-to, à l’ouest par le
Tchyoungtchyeng-to et le Tyen-la-to, à l’est par
la mer du Japon et au sud par le détroit de Corée.
Elle est contournée au nord par la chaîne de
montagnes du Syo-paik-san, à l’ouest par le
Song-na-san, qui prend aussi d’autres noms, et à
l’est par le Oun-mou-san, qui a également diverses
appellations. Toutes ces chaînes, en se
rejoignant, l’entourent de trois côtés et forment
ainsi le bassin du Nak-tong-kang et de ses
nombreux affluents et sous-affluents. Les
productions naturelles de cette province se
rapprochent beaucoup, comme nous l’avons vu durant
le cours de notre voyage, des produits du Japon.
On y trouve de nombreux et anciens vestiges
architecturaux qui indiquent l’importance du rôle
qu’elle a joué dans l’histoire de la Corée: en
effet, c’est l’ancien pays des Tchen-han, qui
devint plus tard le royaume de Sia-lo, dont le
fondateur Ao-ku-sse fit de Taikou sa résidence
habituelle et y installa sa cour. Quelques auteurs
pensent avec raison que le royaume de Sia-lo n’est
autre que le Si-la où les Arabes établirent au xe
siècle d’importants comptoirs commerciaux. Elle
fut le boulevard de la Corée à l’époque des
grandes invasions japonaises, notamment au IIIe
siècle, durant l’expédition commandée en personne
par la princesse japonaise Zin-gul, qui avait
revêtu le costume de son mari, et dans celles du
célèbre sio-goun Hideyosi en 1592 et 1597. Cette
province est aujourd’hui divisée en: 4 fok (mou)
ou grandes préfectures; –1l fou ou
villes départementales; –14 kou
(kiun) ou principautés; –l rei
(ling) ou juridictions particulières; –34 ken
(kian) ou inspections des mines et des salines;
–11 yk
ou directions des postes; –24 fo (phou)
ou places fortes; –2 généraux qui commandent les
troupes; –2 kou-kö
(yu-hsou) ou ducs; –2 commandants de la marine; –2
préfets de police générale; –10 man-ho
(wan-hou) ou chefs de 10 000 hommes; –6 directions
de douane. La population est estimée à 430 000
habitants d’après les documents officiels dont
nous avons parlé. Elle peut donc être presque
doublée pour les raisons données précédemment.
Pendant que je mets en ordre les
notes prises durant mon voyage, mes deux petites
mousmés, assises par terre, me regardent
curieusement, m’offrent, quand il en est besoin,
du feu pour allumer mes cigarettes, et, comme je
les y ai autorisées, fument elles-mêmes leurs
pipes minuscules. Lorsqu’elles les ont allumées,
rien de curieux comme leur mimique assaut de
politesses: elles essuient délicatement
l’extrémité des tuyaux avec du papier de soie, se
les offrent mutuellement avec un sourire, font
l’échange en se saluant d’un gracieux mouvement de
tête, puis aspirent une longue bouffé de fumée et
la laissant s’échapper lentement dans l’air de la
plus coquette façon du monde; bref, en exécutant
ce petit manège sélecto-japonais, elles sont
gentilles à croquer. Mais voici que la porte de
papier glisse dans sa rainure: mon interprète
apparaît et m’annonce que les deux mandarins
représentant à Fou-san le gouvernement coréen
viennent me voir au reçu de la carte que j’ai eu
l’honneur de leur adresser. Je les fais entrer
aussitôt, les remercie de leur aimable visite et
les prie de bien vouloir prendre avec moi une
collation européenne. Ils acceptent, et je n’ai
rien à leur expliquer, car, habitant depuis
quelque temps la concession, tous deux sont au
courant de toutes nos habitudes. Ils me félicitent
de mon voyage, fait pour la première fois par un
Européen, et se mettent à ma disposition pour tout
ce qui dépendra d’eux à Fou-san, Comme je leur
exprime ma gratitude, ils me parlent de l’Europe,
me demandent mille renseignements et en
particulier si j’ai des photographies de mon pays.
Je leur réponds que non, mais que je puis leur en
montrer d’Amérique. Nos mandarins restent
absolument stupéfaits en voyant les maisons à dix
et douze étages de New-York et me prient de leur
expliquer comment on peut bâtir de pareils
monuments, dont ils apprécient parfaitement la
hauteur, grâce aux personnages qu’ils voient aux
fenêtres. Nous passons ainsi ensemble une heure
charmante, et ils se retirent après m’avoir invité
à prendre le thé le lendemain chez eux. Je me
rendis à cette invitation, et je pus constater une
fois de plus combien le Coréen se fait vite à nos
usages, car on me reçut à l’européenne, m’offrant
même du vin de Champagne. Je crois qu’il y a ici
un nouveau débouché commercial pour notre riche
province, que j’ai trouvé chez tous les mandarins
pour le plus gai de nos vins de France. Nos hôtes
sont à peine partis qu’on me remet la carte de M.
Civilini, attaché aux douanes coréennes et faisant
le service du port à Fou-san. Charmé de revoir un
Européen, je vais au-devant de lui. Cet excellent
homme vient de rencontrer ma caravane et, en
apprenant mon arrivée, accourt pour savoir en quoi
il pourra m’être utile, prêt à m’aider de tous ses
moyens, me dit-il, après le curieux voyage que
j’ai osé entreprendre. Je le remercie vivement de
sa sympathie, et à ma demande il me donne, avec un
léger accent italien, les renseignements suivants
sur les communications maritimes de Fou-san avec
les pays voisins. Il n’y a que deux services
régulièrement établis: l’un chinois, l’autre
japonais; le premier part d’ici, double la
péninsule, touche à Tchémoulpo, puis à Tchéfou,
d’où l’on se dirige sur Tien-tsin ou Changhaï, Cet
itinéraire passe par toutes les villes que j’ai
déjà visitées: j’y renonce donc pour prendre la
seconde ligne, qui de Nagasaki se rend
successivement à Fou-san, Gen-san et Vladivostok,
me permettant ainsi de compléter mon voyage en
Corée et d’atteindre la Sibérie. J’exprime à M.
Civilini toute ma gratitude de ses précieux
renseignements et, après avoir échangé quelques
toasts à l’union de nos deux pays, nous nous
séparons, charmés d’avoir fait connaissance. Mes
deux petites mousmés étendent alors à terre les ftons,
légers matelas entre lesquels on se glisse, et je
forme bientôt avec eux un véritable sandwich
humain. Quelques instants après je goûte dans
l’obscurité toute la douceur, la quiétude, le
charme qu’on éprouve en se sentant renaître à la
vie après de longues privations de toutes sortes.
Le lendemain je fais mes visites aux
mandarins, à M. Civilini, puis à M. Hunt,
commissaire des douanes chinoises, et à son
aimable second, M. Watson, qui, grâce à une lettre
de recommandation de l’excellent M. Piry, de
Pékin, m’accueillent de la façon la plus charmante
et me rendent tous les services en leur pouvoir.
Ils me font même l’honneur de venir déjeuner avec
M. Civilini à mon hôtel. Le repas est accompagné
d’une aimable musique jouée dans la chambre
voisine, où plusieurs Japonais se réjouissent en
compagnie de gentilles geishas,
jeunes personnes tout à la fois poètes,
musiciennes, danseuses, etc.; nous allons les
saluer à la fin du repas, puis je pars pour
visiter la ville ou plutôt la concession
européenne, car il y a en réalité quatre Fou-san:
l’ancien, situé le plus au sud, et dont il ne
reste aujourd’hui que des ruines, était une place
forte, occupée pendant plusieurs siècles par les
Japonais, qui en avaient fait un véritable centre
d’affaires servant d’entrepôt à toutes leurs
marchandises. Viennent ensuite le Fou-san coréen,
situé le plus au nord et également fortifié, puis
la concession européenne, dont nous allons parler.
C’est certainement le port le plus important de la
Corée; moins pittoresque que Tchémoulpo, il offre
néanmoins de superbes points de vue du haut des
montagnes verdoyantes qui abritent admirablement
sa baie immense. La ville est dominée par la
colline couverte de cèdres que nous avons
contournée la veille. Au sommet se dresse un
charmant petit temple japonais perdu dans la
ramure; on y accède par de rustiques escaliers
mouvementés et de pittoresques sentiers. Il est
consacré aux divinités protectrices de la mer, et
un grand nombre d’ex-voto le décorent. Ceux-ci
représentent maints naufrages où les Japonais
échappent miraculeusement à la mort par la
puissante intervention des génies ou des déesses.
Toutes ces peintures, qui rappellent celles de
certaines chapelles catholiques, sont, sans être
des chefs-d’œuvre, très intéressantes, vu le
sentiment de foi et de reconnaissance envers les
dieux que l’artiste rend souvent avec beaucoup de
vérité, par l’expression des traits et l’attitudes
des naufragés. Au pied de la colline sainte
s’étend la concession. Construite récemment par
les Japonais, c’est une véritable ville de leur
pays; aussi accaparent-ils tout le commerce de ce
port. Les affaires y sont si fructueuses que
certains marchands gagnent parfois, m’a-t-on dit,
plus de cent mille francs par ans. Malgré cela, il
n’y a guère ici, en dehors des employés de la
douane, que deux ou trois Européens. Ce que
j’appellerai le Fou-san coréen maritime se trouve
à plus d’une lieue du port commercial. On y
arrive, en suivant la côte, par une route qui, du
haut d’une succession de coteaux, domine la mer de
la façon la plus pittoresque. La ville indigène,
fort misérable, est en partie habitée par des
pêcheurs; les maisons de ceux-ci, situées au bord
du détroit de Corée, sont en général précédées de
grands trous circulaires d’environ trois mètres de
diamètre sur un mètre de profondeur, creusés dans
le sol et recouverts de glaise. Quatre pieux de
deux mètres de haut, placés perpendiculairement en
carré autour de ces réservoirs, supportent une
légère toiture de chaume destinée à abriter les
engrais de sardines qu’on y prépare pour les
exporter en grandes quantités au Japon, où ils
servent à fumer les terres. L’interdiction sous
peine de mort d’avoir des rapports avec les
étrangers empêcha pendant des siècles les marins
coréens de prendre la haute mer; aussi aujourd’hui
la plupart de leurs pêcheries sont-elles encore
installées sur le rivage. On y dresse d’immenses
clôtures en bois, avec une seule entrée, vers
laquelle les bateaux pêcheurs poussent les
poissons en les effrayant; puis on ferme
l’ouverture pour y prendre tous les prisonniers.
Comme je reviens à l’hôtel,
j’apprends que le Takachiho
Maru, se rendant à Vladivostok, est arrivé
depuis quelques heures et va repartir
immédiatement. Je me hâte de régler mon compte à
l’hôtel, prends mon billet et arrive à bord
presque au moment du départ. MM. Hunt et Waston,
que j’y trouve, me présentent au capitaine Walter,
au signor Poli, commis des douanes, en vacances,
qui va faire tout le voyage avec moi, et à M.
Brageer, d’origine écossaise, se rendant à Gen-san
pour remplacer un de mes compatriotes, M.
Fougerat, dont le congé quinquennal est arrivé. Un
coup de sifflet retentit, je remercie une dernière
fois les amis qui me quittent; ils s’embarquent et
nous agitons tous nos mouchoirs, eux regagnant
terre dans la barque de la douane, tandis que nous
prenons la mer dans la direction de Gen-san.
Bientôt la nuit arrive, on allume les feux, notre
steamer glisse doucement sur une mer sans vagues;
l’air est tiède et doux à respirer, et, assis sur
le pont, nous jouissons de toute la sérénité de
cette belle soirée, nous laissant aller à la
poésie d’un ciel d’azur qui fourmille de millions
d’étoiles, quand le capitaine Walter nous invite
gracieusement à prendre le cocktail avec lui. Nous
passons dans sa cabine quelques heures charmantes,
car le commandant est un homme aussi aimable que
gai, et mes deux compagnons ne lui cèdent en rien.
C’est ainsi qu’après m’être trouvé si longtemps
éloigné de tout Européen, ce voyage devient pour
moi une véritable fête. Le lendemain matin je
visite notre navire: il est presque neuf et
merveilleusement installé; l’équipage se compose
de Japonais, autant dire d’excellents marins; tout
est donc pour le mieux. Nous suivons à peu de
distance la côte coréenne, formée par une suite de
collines se succédant parallèlement entre elles et
au rivage; elles sont en général peu élevées, mais
très agréablement découpées. Soudain tout
disparaît, nous sommes en pleine brume et devons
bientôt nous arrêter, dans la crainte de buter
contre un îlot qui sert de repère pour la
navigation. La mer est unie comme un miroir, pas
la moindre brise; prisonniers de l’épais
brouillard, c’est seulement au bout de seize
heures que le vent, venant à souffler, dégage
l’atmosphère, nous recouvrons enfin la liberté. Le
point reconnu, le navire prend rapidement la route
de Gen-san, où il arrive avant dans la nuit; ces
retards dans l’arrière-saison ont fréquemment lieu
sur les côtes de Corée.
M. Fougerat vient à bord et nous
emmène chez M. E. Greagh, le commissaire des
douanes, pour lequel j’ai une lettre de
recommandation. Celui-ci nous accueille de la
façon la plus charmante, il me félicite de mon
voyage à travers la Corée, approuve fort au point
de vue ethnographique mon excursion en Sibérie, et
me donne même sur Vladivostok de sérieux
renseignements, qui m’ont été fort utiles là-bas.
Nous achevons la soirée par une sorte de concours
de déclamation en langues française, italienne,
anglaise, chinoise, japonaise et coréenne; cette
dernière fut préférée sous le rapport de la
sonorité, de l’avis de tous, même des consuls
chinois et japonais, venus pour rendre visite au
très sympathique M. Greagh. Celui-ci me fit la
gracieuse surprise de m’offrir, au moment du
départ, un plan de Gen-san exécuté par un artiste
de la localité, plus un morceau d’étoffe d’une
finesse incomparable et d’un brillant aussi beau
que la soie. Ce tissu, fabriqué dans le pays avec
les fibres de certaines orties blanches qui y
poussent en abondance, est un produit absolument
national.
Le lendemain matin, le vent d’est
souffle avec violence, et comme la rade n’est pas
protégée contre lui, il est impossible de se
rendre à terre, car la mer houleuse déferle de
telles vagues sur la côte, qu’aucun bateau n’y
pourrait aborder sans être brisé. Nous devons donc
rester à bord, et patientons en prenant à huit
heures un premier déjeuner au chocolat, à dix, le
thé à la fourchette, enfin, à midi et demi, le
grand déjeuner. Comme la bourrasque ne se calme
pas, nous nous consolons par le thé de quatre
heures, le grand dîner à sept heures du soir et le
thé; je n’ai jamais tant mangé de ma vie, me
contentant partout de mes deux repas comme à
Paris: aussi, après avoir pris un cock-tail final,
lorsque quelqu’un propose d’aller se coucher pour
être réveillé de bonne heure, je donne le premier
l’exemple. Le lendemain matin le vent a cessé,
mais le temps est couvert; parfois pourtant des
échappées de soleil illuminent durant quelques
minutes la magnifique baie à demi entourée d’îles
aux collines boisées. La plus grande activité
règne à bord, car on peut aujourd’hui opérer le
débarquement des marchandises. La capitaine nous
emmène à terre dans son canot japonais, puis,
tournant sa voile, il va avec ses trois
magnifiques chiens chasser le canard sauvage dans
les îles voisines, qui sont des plus agrestes.
Gen-san s’étend au bord de la mer au
pied d’un cercle de collines plantées d’arbres
clairsemés. C’est une ville absolument japonaise;
mais, comme elle est de fondation très récente,
les maisons s’y dressent dispersées çà et là entre
trois petites rivières, que franchissent
d’élégantes passerelles qui donneront beaucoup de
caractère à la ville quand elle sera achevée. Sur
la droite s’ouvre le minuscule port en maçonnerie
des bateaux de la douane dont les dépendances
s’élèvent en arrière; elles consistent en un vaste
baraquement en bois destiné à abriter les
marchandises, et en une jolie maison mandarinale
où l’on tient les écritures.
Au centre des habitations disséminées
des colons japonais est tracé un jardin en
espérance, car les plantations datent de l’an
dernier. Elles entourent capricieusement un rocher
surmonté d’une petite pagode d’étagère, au pied de
laquelle on jouit du magnifique panorama de tout
le paysage environnant, limité par le délicieux
profil des montagnes qui l’entourent de leurs
sites multiples et verdoyantes. Sur la droite
s’élève le consulat du Japon, au milieu d’une
immense cour murée où, en cas d’attaque, pourrait
se réfugier toute la colonie. C’est que les
Japonais, qui se savent détestés des Coréens
prennent, partout où ils sont en groupes, de
grandes précautions, justifiées par les massacres
dont ils furent les victimes à Séoul à la suite
des traités en 1882. Enfin sur la pente même de la
colline centrale s’élève le vaste yamen du
gouverneur, près duquel se trouve l’habitation de
M. Greagh, que mes compagnons et moi allons
remercier d’une gracieuse invitation à dîner.
Puis, quittant la concession, nous nous dirigeons
vers le nord en suivant une route qui se poursuit
le long des collines à travers les champs assez
bien cultivés. Un grand nombre de Coréens y
travaillent; ils me semblent être de véritables
paquets vivants, vu le froid, ayant doublé de
ouate leurs vêtements, ce qui leur donne une
ampleur extraordinaire. Le vrai Gen-san coréen
s’appelle Tok-ouen; il s’étend sur une longueur de
plus d’une lieue; aussi, quoique populeuse, la
ville n’a que deux longues rues parallèles,
coupées de nombreuses ruelles transversales, et
trois places publiques, dont la principale, située
au centre de la ville, sert au marché. On y fait
un grand commerce de fourrures, d’après toutes les
peaux d’animaux sauvages que je vois suspendues
partout; du reste, les nombreuses boutiques devant
les-quelles nous passons renferment des
marchandises de toutes sortes; j’en profite pour
faire divers achats. Toutes les maisons sont
basses, mais avec cette particularité que le
conduit souterrain dans lequel on fait le feu en
Corée se termine ici par un véritable corps de
cheminée en bois ou en natte. Le jardinet qui
entoure chaque propriété est clos de la même
manière: de là résulte un ensemble fort pauvre.
Mes compagnons veulent visiter une auberge
coréenne devant laquelle nous passons; ils y
rentrent pour ressortir aussitôt en s’écriant:
«Mais c’est horrible! comment avez-vous pu vivre
là dedans?» Je tâche de leur ôter cette très
mauvaise impression en leur disant que le
splendide hôtel qu’ils viennent de visiter compte
parmi les plus laids du pays, et nous revenons
gaiement en voyant marcher devant nous, conduits
par des enfants, des porcs dont on fait ici
l’élevage. Ils sont de deux sortes: les natifs et
les croisés; les premiers ont l’air de petits
sangliers, les seconds ressemblent beaucoup aux
porcs américains. Aux uns comme aux autres, on
perce les oreilles, non pour leur attacher des
boucles, mais pour y passer la corde avec laquelle
on les dirige. C’est en cette singulière compagnie
que nous arrivons, à la chute du jour, à la
demeure de M. Greagh, où un excellent repas nous
attend, servi avec tout le confort de la vieille
Angleterre et suivi de la plus charmante soirée.
On y parle naturellement de Gen-san et du
magnifique avenir de ce port par suite de sa
position géographique, qui le met en rapport
direct, par une route déjà très fréquentée, avec
Séoul et, par mer, avec Fou-san, Vladivostok et
Nagasaki, ses proches voisins. Je partage
absolument l’avis de ces messieurs, car je suis
certain qu’avant peu d’années Gen-san sera un
grand centre international en Corée.
Nous causons ensuite des mœurs
locales, des principales productions du pays et
enfin des grands fauves qui y abondent. J’apprends
que les tigres fuient en hiver les grands froids
de la Mandchourie, se dirigent vers le sud-est, du
côté de Vladivostok, et redescendent en Corée le
long de la mer du Japon, en chassant généralement
par couples les animaux sauvages; lorsqu’ils n’en
trouvent plus, pressés par la faim, ils se
rapprochent des villages, et parfois pénètrent la
nuit jusque dans les cours des maisons, comme cela
a eu lieu peu avant notre arrivée chez notre
gracieux amphitryon, dont les deux chiens ont été
ainsi enlevés. Le nombre des grands félins est si
considérable dans la péninsule, qu’on en exporte
chaque année des centaines de peaux, sans compter
la consommation locale, qui est très considérable,
car tous les mandarins se servent de leur fourrure
comme siège officiel. Je demande des
renseignements sur les déprédations de ces fauves.
Beaucoup d’indigènes, m’assure-t-on, en sont
journellement les victimes dans leurs biens et
même leur personne, par suite de réelles
imprudences, comme de coucher hors de leur maison
en été, ou de chasser seul, pour recueillir toute
la prime et le prix de la riche fourrure de ces
animaux. Tout ceci, dis-je, confirme mes idées à
ce sujet, car pour moi le tigre pressé par la faim
se jette seulement sur les isolés et fuit toujours
devant un groupe humain, à moins qu’on ne
l’attaque.
«Pourtant, me répond-on, le prince de
Galles aux Indes a eu un de ses éléphants
assailli.
— C’est une nouvelle preuve de ce que
je viens d’avancer.
En effet, pendant le voyage princier,
pour éviter tout accident, de nombreux rabatteurs
précédaient l’escorte: un tigre passe entre eux
et, les voyant s’éloigner, il pense leur avoir
échappé; mais survient le gros de la caravane: il
se croit cerné et se défend, comme je le disais
tout à l’heure.
—Donc, pour vous, ces grands félins
ne sont nullement à craindre?
—Pour les explorateurs du moins,
puisqu’ils sont nécessairement accompagnés de leur
suite.
—Parions que vous ne raconterez pas
cela dans le récit de vos voyages.
—Je le ferai, au contraire: je sais
bien qu’en parlant ainsi, je me priverai de
raconter d’émouvants récits, mais j’aurai du moins
la satisfaction d’avoir dit la vérité, et, chose
plus rare, d’être cru, puisque, à mon retour en
France, j’aurai parcouru de nombreux pays habités
par ces félins, notamment la Corée, la Sibérie,
l’Indo-Chine et les Indes. J’ajouterai, pour
convaincre les incrédules, que, malgré toutes les
légendes, les tigres en réalité ont rendu bien
plus de services aux explorateurs et
particulièrement aux éditeurs qu’ils ne leur ont
fait de mal, car on cherche vainement dans nos
annales la fin tragique de l’un de nous, terminant
le cours de ses explorations dans le ventre d’un
grand fauve». Et chacun de rire. «Pour moi,
continuai-je, les extraordinaires relations de
tempêtes et les terribles luttes corps à corps
avec les bêtes féroces que j’ai lues il y a bien
longtemps, me semblent être cause de la terreur
des grands-parents et de l’opposition qu’ils
mettent chez nous au départ pour l’étranger de
notre ardente jeunesse, tout cela au grand
détriment de la famille, de la patrie et au moment
où la lutte pour la vie rend de plus en plus
nécessaire la vive expansion de toutes nos forces
nationales». Lorsque j’eus achevé cette petite
tartine, chacun m’approuva. Puissé-jc être aussi
heureux en France et voir bientôt partir tout un
essaim de jeunes voyageurs, entraînés déjà par
l’état militaire où ils ont tous passé. La soirée
achevée, comme nous marchons à travers champs pour
regagner le steamer, voici que derrière nous
retentit, dans le silence de la nuit, le sinistre
miaulement du tigre, il redouble: est-ce que je
vais enfin en voir un? Nous nous arrêtons, et tout
à coup bondit au milieu de nous l’ami X ... , qui
nous donne cette petite distraction de famille!!!
Nous lui répondons par un miaulement général
d’adieu; après quoi, comme dans la chanson, chacun
s’en va coucher, les uns à bord, et les autres ...
chez eux.
Deux heures après, nous quittions la
Corée pour nous rendre en Sibérie, où j’espérais
compléter mes études ethnographiques dans le nord,
comme je l’avais fait à l’est en parcourant une
partie de Yéso et tout le Japon, enfin à l’ouest
en visitant la Chine du nord, du centre et du sud;
on ne peut en effet connaître l’ethnographie d’un
peuple que si l’on a des idées générales sur les
pays qui entourent. Je fus enchanté de ma
détermination, car, grâce à l’aimable accueil de
M. de Bussy, conseiller d’État à la cour de
Russie, et à ses remarquables travaux sur les pays
septentrionaux, quil étudie depuis plusieurs
années, enfin à la très intéressante collection
sibérienne réunie par lui, j’ai pu constater une
étrange parenté entre les anciennes tribus
sibériennes, particulièrement les Tongouses et les
Coréens. Sans entrer dans des considérations
spéciales qui seront développées dans notre
volume, nous nous contenterons de dire ici que
cette affinité se manifeste aujourd’hui de la
façon la plus inattendue; en effet, tandis qu’on
ne rencontre presque aucun Coréen en Chine et au
Japon, c’est par milliers qu’on les compte sur les
bords de l’Amour et à Vladivostok, où ils ont
accaparé toute la batellerie. Un immense commerce
y est fait également par les Chinois, mais on n’y
compte en dehors des Russes que quelques rares
Européens. La ville, située au fond d’une immense
baie, est protégée par de pittoresques collines
couvertes de sapins, de mélèzes, de pins et de
bouleaux au tronc d’argent. Les flottes du monde
entier pourraient s’abriter dans ce port immense
et qui, fermé par les glaces pendant deux mois de
l’année, n’en est pas moins appelé au plus grand
avenir, car Vladivostok, dont l’origine est
récente, est déjà la reine du nord, et sa
prospérité ne fera que s’ accroître. Bientôt en
effet un réseau de chemins de fer reliant entre
eux les lacs et les fleuves sibériens sillonnés de
bateaux à vapeur, la mettra en relations
d’affaires non seulement avec tout l’empire russe,
mais avec l’Europe entière et toute l’Amérique du
Nord; une seule rivalité pourrait être craindre,
c’est le développement probable du nouveau port
ouvert que la Corée vient d’octroyer uniquement à
la Russie, à sa frontière nord-est, car, libre de
glace en toute saison, il est appelé à devenir le
centre de tout le commerce du monde septentrional.
Après une excursion aux environs de
Vladivostok, nous reprenons la mer et retouchons
successivement à Gen-san et à Fousan, où nos amis
nous font grande fête; quand donc me
permettront-ils à mon tour de les recevoir aussi
joyeusement à Paris? car la cordialité qui règne
là-bas entre les Européens est vraiment une chose
charmante. Certes, en quittant pour la seconde
fois la Corée, je croyais y avoir fini mes études
locales: eh bien, il me restait à éprouver les
émotions d’un typhon dans ses eaux. En effet,
sortis à la nuit de la baie de Fou-san, nous
trouvons au large une mer assez grosse; l’ami
Fougerat, qui a déjà eu quelques démêlés avec
elle, craignant de voir naître de nouvelles
difficultés, se retire dans sa cabine et nous
restons avec M. Poli à jouir du plaisir tout
spécial de nous sentir quelque peu balancés par la
mer; sur un signe du capitaine Walter, nous le
rejoignons aussitôt sur la dunette, car du pont on
voit très mal, et de là-haut au contraire on est
au centre du plus admirable panorama maritime.
Quoique le temps soit couvert, la lumière opaque
de la lune passe à travers la fine couche de
nuages qui nous cache le ciel et, tout autour de
nous, les flots moutonnant de blancheur: c’est
superbe. Au bout d’une heure l’ami Poli, se
sentant fatigué de nos plaisirs de la veille, va
se coucher et je reste seul avec le commandant. Le
ciel maintenant est devenu absolument obscur, il
semble que la lumière vienne de la mer, qui est
comme illuminée par l’écume éblouissante des
vagues. Elles se brisent avec fracas et vont sans
cesse grossissant, car le vent s’élève de plus en
plus. Nous roulons maintenant sur les lames d’une
épouvantable manière: parfois notre steamer dresse
dans l’air sa pointe aiguë, puis l’enfonce dans la
mer, comme s’il voulait sonder l’abîme, ou bien,
pris de travers par une large vague, il se couche
sur le flanc comme pour mourir: c’est vraiment
terrifiant. Soudain les mâts crient, un horrible
craquement se fait entendre, et notre navire, un
instant soulevé en arrière, retombe avec fracas
dans les flots en même temps qu’une vague énorme
nous inonde: mais le steamer se redresse, remonte
sur les crêtes éblouissantes, et nous dominons la
mer déchaînée. Oh! que c’est beau, que c’est
splendide! «Bon marin, dit le capitaine Walter en
me frappant sur l’épaule. —Merci, commandant! car
je vous dois le plus beau spectacle que j’aie vu
de ma vie». Et, serrant fortement nos mains à la
barre d’appui de la dunette, nous jouissons de
l’horreur grandiose, la nature déchaînée, qui
semble retourner au chaos. En vain le vent
augmente, la tourmente redouble et les vagues se
précipitent sur nous comme un suprême assaut, je
suis maintenant calme et tranquille, je sens que
le génie de l’homme est maître enfin de la
tempête, qu’il a su construire l’insubmersible, le
mène, dirige et conduit où il veut, car la volonté
du capitaine le gouverne plus sûrement que le
cavalier pressant les flancs de sa monture. Au
moment où, transporté par ce triomphe de l’esprit
sur la matière, je me crois presque un Dieu, une
épouvantable crise de toux me prend et me voici
haletant au-dessus de l’abîme. Bientôt un semblant
d’accalmie se fait autour de nous; le capitaine,
touchant mes vêtements transpercés d’eau, me dit
qu’il faut rentrer, et comme le second monte au
banc de quatre, nous redescendons ensemble. La
marche est vraiment difficile, car le tangage mêlé
au roulis est tel que pour avancer il nous faut
attendre qu’un mouvement du steamer permette à nos
mains de saisir en nous élançant un cordage ou une
aspérité quelconque pour ne pas rouler sur le
pont. Arrivés au salon malgré notre parfaite
instabilité, nous préparons l’invraisemblable
cock-tail qui doit nous réchauffer. Ce que cela
n’a pas été commode enfin! C’est fait, le
capitaine remonte à son poste, et moi, absolument
inondé faute de caoutchouc, je rentre frissonnant
dans ma cabine, me change complètement et me sens
bientôt pénétré par la douce chaleur qui
m’entoure. A peine couché, je suis brusquement
soulevé et jeté hors de ma case, en même temps
qu’au craquement des bois du navire, au souffle
haletant de la machine, au sinistre sifflement de
l’hélice tournant dans l’air, se mêlent tout à
coup l’effroyable choc d’un énorme paquet de mer
et un bruyant tintamarre de vaisselle brisée, puis
un grand silence suivi d’un roulement formidable
produit sur le pont. «Montez donc voir ce qu’il y
a», me dit de sa cabine le signer Poli. «Tous mes
regrets, mon cher, mais je suis déshabillé et n’ai
nullement envie de me faire écrabouiller par ce
qui roule là-haut. Bonsoir, je dors». Je tâche de
le faire en dépit des invraisemblables mouvements
du navire dont maintenant je me rends compte
absolument comme si j’étais sur la dunette du
capitaine, qui lutte vaillamment là-haut pendant
que, brisé de fatigue, je m’endors bientôt sous sa
garde et celle de Dieu. Le lendemain, je m’éveille
au grand jour, m’habille rapidement et traverse le
salon, absolument ravagé: partout de la vaisselle
cassée, et deux des bras fixés fortement aux
parois, et qui portent les lampes au coin du
salon, gisent à terre sans que je puisse
m’expliquer comment ils se sont brisés; le pont
est dans un désordre inexprimable: les deux
tonneaux cerclés de cuivre, hauts de près de 2
mètres, se trouvant à l’arrière, ont été enlevés
par la vague malgré les quatre énormes contreforts
en fer qui les scellaient au navire. La mer
maintenant est simplement onduleuse, car nous
avons franchi les îles Goto, qui nous mettent à
l’abri de ses fureurs. Je monte rejoindre le
capitaine: il est rayonnant du devoir accompli et
me tend affectueusement les mains en me disant:
«Belle tempête». Oh! le brave homme et comme je
lui suis reconnaissant de tout ce qu’il m’a permis
de voir. Notre navire, avarié, entre bientôt dans
le golfe. Quoique le ciel soit couvert de nuages
gris cendré, j’en admire encore le paysage, qui
est si splendide par un rayon de soleil, comme du
reste toutes les vues côtières du Japon. Je ne
parlerai pas plus de Nagasaki que je n’ai fait de
Chang-Haï, dont la concession européenne est le
Paris de I’Extrêrne-Orient: ces deux villes sont
trop connues. Je dirai seulement que le typhon
dont nous avons souffert avait étendu ses ravages
sur la côte, car à notre hôtel, comme dans toutes
les maisons japonaises situées sur les hauteurs,
les clôtures en bois et les toitures avaient été
enlevées en partie par la tempête. Ceci nous vaut
maintenant les regards curieux de tous ceux qui
savent que nous y avions échappé. Pourtant en
vérité on ne court presque aucun danger sur les
grands steamers actuels, grâce à leur admirable
aménagement, aux connaissances que nous avons
maintenant du régime des vents, etc. C’est, hélas!
à Nagasaki que je dus me séparer du très aimable
capitaine Walter et de mes deux charmants
compagnons pour reprendre la grande ligne des
Messageries maritimes et achever mon tour du
monde.
Quelques
esprits chagrins, en terminant la lecture de ce
récit, m’accuseront peut-être d’avoir caché bien
des dangers, atténué bien des fatigues, embelli
bien des choses. Oui, je l’ai fait et de propos
délibéré, car en agissant ainsi je suis infiniment
plus près de la vérité absolue que si j’avais
dramatisé à mon profit les moindres événements.
Certes, en parcourant tant de pays en partie
inexplorés, deux ou trois fois ma vie a été en
péril, mais pendant ce long voyage ceux qui sont
restés à Paris ont-ils couru moins de dangers?
Qu’ils pensent au pot de fleurs qui peut vous
tomber sur la tête, à la voiture qui vous broie
sur le boulevard, au duel que la galerie vous
impose, etc., et que, pendant ce temps-là, l’air
pur de la mer ou de la montagne revivifiait mon
sang, des observations nouvelles éclairaient
chaque jour mon esprit, enfin de rudes labeurs
rendaient mon cœur plus indulgent et plus tendre à
tous. Et j’ajoute: si de véritables explorations
présentent de telles facilités relatives, combien
par là même devient aisé n’importe quel voyage
dans les pays ouverts à tous! Laisserons-nous donc
aujourd’hui les étrangers parcourir seuls des
contrées où nous les avons presque partout
précédés, et renoncerons-nous à la glorieuse
carrière quand de récents exemples parmi nous ont
fait de l’exploration un véritable métier de
princes?
C’est donc à vous, ô mères, que je
m’adresse, car les pères sont déjà à demi
convaincus; si votre fils, après avoir fait selon
le pays où il veut se rendre, l’apprentissage
absolument indispensable, soit de la montagne en
Suisse, du froid en hiver à Saint-Pétersbourg, ou
de la chaleur en été Biskra, persiste à vouloir
partir, si réellement vous l’aimez, loin de le
retenir, excitez-le plutôt dans sa mâle énergie,
et s’il est respectueux des mœurs et des droits de
tous, s’il prend les précautions hygiéniques
relatives à chaque climat, s’il est chaste et
surtout sobre, il vous reviendra plus robuste,
plus aimant et plus digne. Au lieu de l’épuisement
d’énervants plaisirs, les généreuses fatigues du
voyage le fortifieront à tout jamais, son esprit
se développera par toutes les connaissances
acquises, et son cœur vous en aimera davantage, en
sentant mieux le bonheur de vous serrer dans ses
bras. Quelle joie alors de le retrouver devenu
quelqu’un et plein de jeunesse, de le voir écouté
respectueusement par ses camarades, que dis-je,
par les hommes faits et même les vieillards,
heureux d’entendre de sa bouche tout ce qu’il a
vu, appris, rapporté pour lui, pour les siens,
pour la patrie!
Ainsi
revenait nos pères de leurs héroïques expéditions,
où ils avaient fait partout connaître, admirer,
aimer la France, augmentant ainsi son influence,
sa richesse et sa grandeur.
Charles
VARAT.