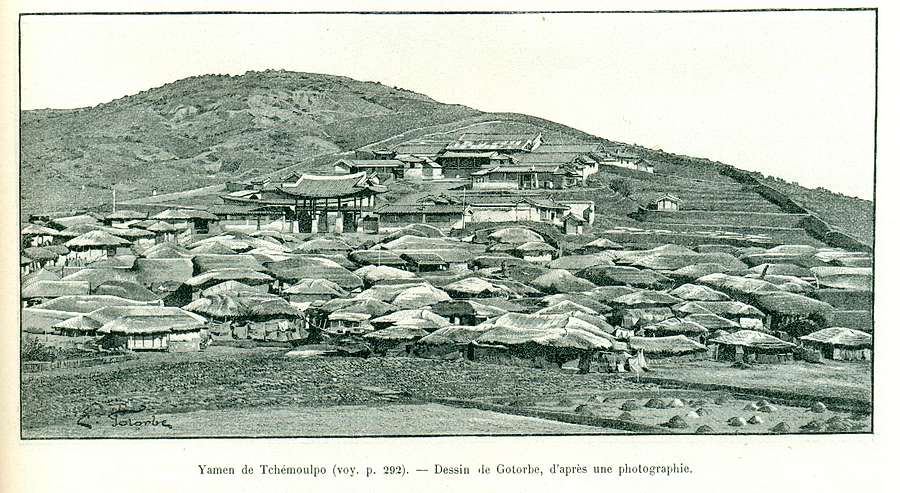
Voyage
en Corée
par
Charles
Varat
Explorateur
chargé de mission ethnographique par le ministère
de l'Instruction publique
1888-1889 —
texte et dessins inédits
Le Tour du Monde LXIII, 1892
Premier Semestre. Paris : Librairie Hachette et
Cie.
Pages 289-368
Section I. [Click here for the
other sections: Section
II, Section
III, Section IV,
Section V.]
Gravures (toutes)
[Click here for the English
translation: Section
One; Section
Two; Section
Three; Section
Four; Section
Five.] Engravings
(all)
La Corée ouverte. – Tchéfou. – Visite
au consul. – Le départ. – Comment je rencontrai un
prince coréen et ce
qui en advint.—Tchémoulpo. – En route. – Arrivée à Séoul. – Un
hôtel japonais. – A la légation de France. – Ma vie
séoulienne. – Organisation administrative et sociale
de la Corée. – Topographie de la capitale et de ses
environs. – Ses monuments. – Télégraphie lumineuse,
postes. etc. – Nos représentants
Ce récit de voyage
n'est qu'un fragment du volume que M. Charles Varat
doit publier prochainement sur la Corée. Ce volume
sera divisé en trois parties: la première résumera les
travaux dont ce pays, si peu connu, a jusqu'ici été
l'objet; la seconde contiendra le récit même du
voyage, que nous donnons aujourd'hui; dans la
troisième, enfin, l'auteur se propose de déterminer,
tant d'après ses observations personnelles que d'après
les travaux de ses devanciers, la personnalité
ethnique du peuple coréen. C'est donc seulement la
partie anecdotique que nous détachons à l'avance du
travail de M. Varat; elle fera, certainement,
pressentir tout l'intérêt du reste.
La
Corée était naguère si absolument fermée au reste du
monde, qu’en dehors des ambassades chinoises
annuelles, sévèrerement contrôlées à la frontière du
Canard-Vert, nul ne pouvait y pénétrer sous peine de
mort. Les Pères missionnaires bravèrent les premiers
cette interdiction barbare et parvinrent à franchir,
durant la nuit, le fleuve qui forme la frontière, que
de nombreux douaniers gardaient avec un soin féroce.
On dut bientôt renoncer à ce passage; le gouvernement
coréen, informé de la violation de son territoire,
avait dressé des chiens à la poursuite des étrangers.
Ce fut dès lors sur des jonques, montées par des
chrétiens chinois, que les Pères, abrités par les îles
de la côte, purent accoster les barques de leurs
futures ouailles, qui, au péril de leur vie,
introduisaient les missionnaires dans le pays. On les
dérobait à tous les regards au moyen du costume
d’orphelin coréen dont l’immense chapeau voile
entièrement le visage, et dispense, vu
les rites du grand deuil, de toute question
indiscrète. Aujourd’hui, grâce aux traités conclus, un
simple passeport nous suffit pour pénétrer en Corée:
par terre, en franchissant à la frontière chinoise le
Ya-lou-kiang, en coréen Apnok-hang, ou à la frontière
russe, le Mi-kiang, en coréen le Touman-hang : par mer
en se rendant de Nagasaki à Fousan, Gensan et
Vladivostok, ou réciproquement; enfin du golfe de
Pe-tchi-li en s’embarquant à Tchéfou pour Tchémoulpo.
Je choisis cette dernière route: elle mène plus
directement à la capitale, point de départ, mieux
encore centre des études ethnographiques que je
voulais faire.
Je quittai donc la grande ligne des
Messageries maritimes allant de Marseille à Yokohama,
pour prendre à Chang-haï un des steamers qui mènent à
Pékin, par Tien-tsin, en faisant à mi-route escale à
la charmante ville chinoise de Tchéfou. Si j’étais
chargé d’ajouter un qualificatif à son nom, je
l’appellerais Tchéfou-les-Bains. C’est en effet le
Dieppe chinois, où chaque année, durant la belle
saison, tous les Européens, anémiés par un long séjour
en Chine, se rendent en foule de tous les ports
ouverts. Ils y retrouvent, grâce à l’air salin qu’on y
respire, non seulement la santé, mais de nouvelles
forces pour résister au climat débilitant de
l’Extreme-Orient. Aussi à côté de la ville chinoise
s’élève un véritable sanatorium où l’on jouit de
l’aimable vie de nos plages les plus élégantes, grâce
aux nombreux hôtels qui y sont établis, donnant à tour
de rôle fêtes, bals, concerts, etc., et à de
délicieuses excursions en mer, ou dans les montagnes
et vallées environnantes.
A
peine arrivé à Tchéfou je me rends chez M. Fergusson,
consul de Belgique et vice-consul de France et de
Russie, pour lui demander quelques renseignements
pratiques sur mon voyage. Il me dit que le moment est
mal choisi, car on a dû récemment débarquer les
fusiliers marins des flottes européennes pour protéger
les consulats pendant les dernières émeutes qui ont
troublé Séoul. «Mais tout cela est heureusement
terminé. Puis-je donc raisonnablement avoir fait plus
de la moitié du tour du monde et m’en retourner par
l’autre côté sans avoir pénétré en Corée, but
principal de mon voyage?
—Réflexion
faite,
vous pouvez aller jusqu’à Séoul; quant à traverser la
Corée pour vous rendre à Fousan, voyage que nul
Européen n’a encore fait, renoncez-y.
—Il
faut cependant que quelqu’un commence et je désirerais
que ce fût moi, étant venu absolument pour cela.
—C’est
impossible
dans l’état actuel des choses, réplique mon
interlocuteur: la famine commence à se faire sentir
sur la côte est, vous tomberez inévitablement entre
les mains des bandits. Ils viennent de s’organiser en
troupes, attaquent les villages, pillent les maisons,
violent les femmes et massacrent tout ce qui s’offre à
eux ..., même les voyageurs, ajouta-t-il en souriant.
—Vos
informations
me réjouissent médiocrement, mais ne peuvent changer
ma résolution.
—Vous
la modifierez à Séoul».
Je rappelle au
consul la fable des bâtons flottants, le remercie de
son aimable accueil, et me prépare à partir par le
premier bateau se rendant en Corée.
J’attends
plusieurs
jours, ayant manqué la correspondance bi-mensuelle;
mais, accueilli de la façon la plus gracieuse par
l’aimable colonie anglaise, le temps passe rapidement
et c’est avec un véritable sentiment de tristesse
qu’un soir de bal-concert je dois brusquement me
rendre au bateau de Tchémoulpo. Le steamer ne fait que
toucher à Tchéfou, car à peine mon sampan l’a-t-il
rejoint au large que nous partons, par une nuit noire,
humide et glaciale. Personne sur le pont; je pénètre
au salon, il est désert; me voyant seul, je rentre
dans ma cabine et regrette d’autant plus vivement
l’aimable réunion de femmes brillamment parées que je
viens de quitter. Je les évoque par la pensée et les
revois bientôt glisser souriantes autour de moi, qui
n’ose rouvrir les yeux, craignant de voir s’évanouir
leurs fugitives et charmantes images. Je m’endors
ainsi, doucement bercé par la mer.
Après
une nuit d’une heureuse navigation, je monte le matin
sur le pont. Le navire suit la côte chinoise; elle se
déroule sous nos yeux avec ses nombreux sommets
onduleux et déboisés, qui se fondent mélancoliquement
dans un ciel de nuages gris. Le capitaine du Suruga Maru
et son second se montrent d’une rare amabilité pour
moi, ainsi qu’un Anglais se rendant par mer à Fousan.
Les autres voyageurs sont japonais ou chinois; l’un de
ceux-ci parle admirablement le français et me sert
d’interprète auprès de ses concitoyens. Pendant le
déjeuner, le capitaine me demande si j’ai déjà
rencontré des Coréens. Je raconte qu’au Japon, à bord
du vapeur qui devait me conduire de Kobée à Nagasaki,
je vis, quelques instants avant le départ, se diriger
vers nous deux grandes barques remplies de
fonctionnaires japonais et d’un groupe d’hommes
étrangement costumés. On me dit que c’était un prince
coréen avec sa suite. A l’inspection rapide des traits
de leurs visages, et de leurs vêtements absolument
nouveaux pour moi, je sentis de suite qu’un riche
domaine ethnographique m’est ouvert en Corée: je ne
les quittai plus des yeux.
Les
fonctionnaires
japonais, après avoir installé cérémonieusement à bord
le prince coréen, lui souhaitent un bon voyage et se
retirent au moment où nous levons l’ancre. A peine
sommes nous en marche, que le prince, jeune homme
d’environ vingt cinq ans et d’une rare distinction
native, frappé de la curiosité avec laquelle je
l’examine de loin, ainsi que ses compagnons, s’avance
vers moi en souriant. Je me lève aussitôt, je vais
audevant de lui: nous nous rejoignons, et, faute d’une
langue commune pour nous entendre, nous exprimons nos
sentiments réciproques par une pantomime sympathique
aussi vive qu’anirnée. Je lui tends des cigares, il
m’offre des cigarettes, prend amicalement ma montre
dans ma poche et me fait examiner celle qu’il vient
d’acheter. Puis vient le tour de nos lorgnettes, de
nos vêtements, enfin de tout ce qui peut être le sujet
d’une mutuelle curiosité. Tout cela est accompagné de
rires, de poignées de main, de mots anglais, japonais,
coréens et français que certainement nous ne
comprenons pas tous deux. Les trois vieillards,
conseillers du prince, et ses nombreux serviteurs
groupés autour de nous se lèvent à notre exemple,
quand notre curiosité est satisfaite, et nous nous
retirons dans nos cabines en nous faisant mutuellement
mille politesses, au grand étonnement d’un groupe d'
Anglais et de jeunes Anglaises qui se regardent
souriant et ne s’expliquent pas cette sympathie
inattendue.
Le
lendemain matin, j’étais assis sur le pont, non loin
des charmantes misses dont j’ai parlé, quand apparaît
brusquement le prince, non plus dans son costume de
soie rose recouvert de gaze, mais revêtu seulement
d’un large pantalon bouffant en soie blanche et d’un
court veston bleu ciel.
Le
prince s’élance vers moi, sa figure exprime une grande
anxiété, mêlée à un vif sentiment de confiance. Il me
le témoigne aussitôt en relevant sa large manche
jusqu’aux épaules, pour me montrer avec inquiétude les
mille piqûres qui mouchettent sa peau d’une rare
blancheur. Je lui fais comprendre par signes qu’il a
été probablement victime des moustiques. Il m’indique
de la tête que c’est beaucoup plus grave, et,
brusquement, me tournant le dos. il relève son veston,
abaisse son pantalon et me montre les premiers
quartiers d’un astre que je m’empresse d’éclipser en
le recouvrant, au bruit des rires et des cris
d’indignation des jeunes misses qui assistent à cette
consultation extra-médicale. Pour mettre y fin, je
prends le prince par la main, le conduis gravement à
la salle de bains et l’invite à y prendre place. Il
comprend, me remercie, et voilà comment, avant d’aller
en Corée, j’ai vu sur toutes ses faces un prince
coréen. Cette histoire amusa beaucoup l’indulgent
capitaine du Suruga
Maru, ainsi que mes très aimables compagnons:
c’est ce qui me décide à la raconter ici.
Le
lendemain matin, réveillé par le brusque arrêt du
bruit d la machine, je monte sur le pont et suis ravi
par l’admirable situation de la baie de Tchémoulpo.
C’est une des plus belles que j’aie vues de ma vie.
Des montagnes pittoresquement dentelées s’élèvent
partout sur la côte et sur les îles qui forment le
port; elles l’abritent de la façon la plus complète et
la plus charmante dans un véritable nid de verdure
qu’illuminent en ce moment les premiers rayons du
soleil levant.
Sans
perdre un instant, je laisse à bord mon bagage, que je
ne sais où remiser à terre, et me précipite dans un
sampan. Un quart d’heure après, je foule enfin le sol
de la Corée, jouissant une fois de plus de l’étrange
impression de me trouver brusquement seul au milieu
d’une population dont je ne connais ni la langue, ni
les mœurs, ni les costumes. Des centaines de
terrassiers coréens, les jambes demi-nues, sont là en
train de disposer les terres qui doivent former le
quai de débarquement. De nombreux portefaix, revêtus
d’une culotte et d’un veston en coton blanc, apportent
des matériaux au moyen d’un crochet en bois
grossièrement équarri, analogue au nôtre et, maintenu
en équilibre sur le dos par une corde qui s’appuie sur
le front. Leurs cheveux forment une tresse qui se
dresse comme une corne au sommet de la tête. Tous sont
nu-pieds ou portent des chaussures de paille, où le
pouce n’est pas séparé des autres doigts comme chez
les Japonais; le Coréen, du reste, les dépasse de
beaucoup comme taille, et son visage a un tout autre
caractère.
Çà
et là, des femmes apportent à leurs maris leur
nourriture. Elles sont fort laides et disgracieuses,
se rasent les sourcils en ligne étroite afin de
décrire un arc parfaitement net. Leurs cheveux huilés,
épais, noirs et à reflet roux, forment, par je ne sais
quel artifice, une énorme coiffure qui charge
lourdement leur tête. Toutes ont l’air plutôt
empaquetées qu’habillées, et je suis étrangement
surpris de voir la plupart d’entre elles laisser
sortir complètement leurs seins de leurs vêtements,
ouvert horizontalement sur la poitrine. Plus loin
jouent, en poussant de grands cris, quelques jeunes
gens; si je n’avais vu leurs mères, je les prendrais
pour des femmes, tant mon regard est trompé par la
grâce de leurs traits, leurs longues tresses
flottantes et leur singulier pantalon bouffant qui
ressemble à une jupe. Je quitte le port et entre dans
la ville coréenne, si l’on peut donner ce nom au
rassemblement de quelques centaines de toits de
chaume, qui s’élèvent de trois à quatre pieds
au-dessus du sol, formant de véritables tanières où
l’on ne pénètre que courbé à demi.
Une
rue et quelques étroites ruelles constituent ce grand
village coréen, né d’hier par suite de l’ouverture du
port de Tchémoulpo aux Européens. Il est dominé par le
vaste yamen du gouverneur, dont l’énorme toiture,
légèrement relevée, rappelle les constructions du même
ordre en Chine, mais avec de notables différences. En
effet, cet immense bâtiment paraît de loin n’avoir que
des fenêtres; cela tient à ce que l’édifice, surélevé
de quelques pieds au-dessus du sol, s’étend sur un
vaste plancher où chaque fenêtre forme une véritable
porte permettant de circuler sous l’espèce de véranda
formée autour de l’édifice par la toiture débordante.
On jouit de là d’une magnifique vue de la baie. Elle
semble absolument fermée par les îles, qui forment un
immense amphithéâtre maritime de l’effet le plus
imposant. Au centre s’élève un petit îlot couvert de
verdure, et sur la droite, la rivière de Séoul,
coulant en capricieux méandres, étincelle sous les
rayons du soleil. Je me dirige de ce côté, et passe
par la concession japonaise. Je me crois de nouveau
transporté au Nippon.
Quel
contraste avec la misère du hameau coréen que cette
ville propre, gaie, affairée, où les Japonais ont
apporté avec eux leurs mœurs, leurs coutumes, leurs
usages! Aussi ont-ils absorbé ici la plus grande
partie du commerce, et leurs établissements prennent
chaque jour plus d’importance, n’ayant guère pour
concurrents que quelques maisons chinoises. Je remonte
la large rue bordée de coquettes maisons qui traverse
le milieu de ce quartier, et arrive à la concession
européenne, occupée seulement par deux ou trois
négociants. J’y fais la connaissance du très aimable
M. Schœnike, commissaire des douanes, et de son
second, un gai Français, M. Laporte, qui me conduisent
chez le jeune et charmant consul d’Angleterre, où nous
sommes reçus le plus gracieusement du monde. Ces
visites faites, je m’installe dans un petit hôtel
européen tenu par un Triestin. Celui-ci m’engage à
aller chercher au plus vite mon bagage au bateau si je
ne veux pas le faire porter à dos d’homme, car, la
marée étant ici de 26 à 30 pieds, la mer va bientôt se
retirer à plusieurs kilomètres. En effet un petit
navire ancré à l’avant de notre vapeur est déjà à sec
et maintenu debout par d’énormes poutres: il a l’air
de loin d’une immense araignée. Je me hâte donc et
suis de retour avec ma barque avant que la vaste baie
soit transformée en une immense plaine de sable qui
permet de se rendre à pied à l’île verdoyante dont
j’ai parlé. Ce brusque changement se produit deux fois
par jour et modifie du tout au tout l’aspect général
et le ton du paysage, qui passe successivement d’un
fond vert de mer à un jaune sablonneux.
Durant
cette journée la petite colonie européenne me fait
grande fête et m’engage fort à aller à Séoul par un
petit service journalier de bateaux à vapeur qui vient
d’être organisé. Mais, le bateau n’étant pas arrivé le
lendemain, je prends, sans plus attendre, congé de mes
nouveaux amis, les remercie chaleureusement et pars.
Ma petite caravane est composée de deux chevaux pour
mes bagages et mes instruments, d’un troisième pour
moi, enfin des trois palefreniers propriétaires des
montures. Ces hommes, vêtus comme les terrassiers ont
une longue pipe d’environ 1m. 20, qu’ils placent,
quand ils ne fument pas, entre leur dos et leur
veston. L’extrémité du tuyau où l’on aspire ressort
derrière le col, tandis que le fourneau en métal se
présente beaucoup plus bas, ce qui offre un aspect des
plus bizarres lorsqu’ils marchent ainsi, les bras
ballants. Nous traversons à grands pas plaines,
vallées, coteaux, tantôt au milieu des champs
cultivés, tantôt à travers de hautes herbes. Partout
des chevaux ou plutôt de petits poneys, ou de superbes
taureaux, quelquefois attelés à une charrette
rudimentaire. Je ne reverrai plus ces charrettes, dans
mon voyage, car elles font uniquement le trajet de
Tchémoulpo à Séoul, un des rares parcours en Corée où
l’on trouve sur une certaine longueur un semblant de
route.
Nous
arrivons au pied d’un contrefort, le Pel-ko-kai; il
est si raide que pour ménager mon cheval je le
franchis à pied; puis je continue à suivre la vallée,
fort intrigué par les arrêts successifs de mes hommes
dans de petites chaumières coréennes au-dessus du toit
desquelles une longue perche tient suspendu en l’air
un petit panier oblong en osier. Je poursuis donc seul
ma route à travers la campagne, rattrapé de temps à
autre par les palefreniers. Bientôt, à leur marche
titubante, je ne tarde pas à connaitre la cause de
leurs fréquentes disparitions; elle m’est absolument
confirmée, quand l’un d’eux vient à tomber sur le dos
d’une si fâcheuse manière qu’il en casse sa longue
pipe.
J’aurai
eu jusque là d’assez tristes compagnons de voyage si
la boisson les eût rendus méchants; mais ils restent
dans la période du grand attendrissement, m’offrant
des fruits qu’ils ont achetés je ne sais où, et
insistant avec véhémence pour me faire fumer leurs
grandes pipes. Je parviens à les maintenir dans ces
aimables dispositions et à les empêcher de s’éloigner
désormais des chevaux, en leur faisant comprendre par
gestes que si je suis content d’eux, ils auront un bon
pourboire à Séoul. C’est ainsi qu’après avoir passé
Sadari-chou-mak, nous arrivons au petit bourg de
d’Ori-kol-chou-mak, où nous devons nous arrêter pour
le repos et la nourriture des chevaux. Je refuse
d’entrer dans la soi-disant auberge, dont un seul
regard m’a révélé la parfaite malpropreté, et reste
dehors, assis sur mes malles. Ma présence excite une
vive curiosité chez les habitants, qui m’entourent
respectueusement. Ils se montrent vivement intrigués
de mon costume, particulièrement de mes gants, de mes
guêtres de cuir, et me demandent très poliment à les
toucher. Après une halte d’environ deux heures nous
repartons enfin, à la suite d’un Chinois admirablement
monté. Il prend la tête de la caravane, à ma grande
satisfaction, car nous marchons maintenant beaucoup
plus vite, car j’ai excité à le suivre mes
palefreniers, de plus en plus émus. Nous parcourons un
pays beaucoup plus plat et atteignons bientôt un bras
du Hang-kang, que nous traversons à gué; alors nous
nous trouvons dans une immense plaine de sable,
probablement couverte par les eaux à la mauvaise
saison. Par places les cailloux s’accumulent dans ce
véritable petit Sahara, où les chevaux et les hommes,
qui se sont déchaussés, avancent avec peine, leurs
pieds s’enfonçant à demi dans le sol sablonneux.
Enfin, nous voyons au loin le fleuve, que nous
rejoignons pour le passer en barque, et arriver ainsi
à Mapou, véritable port de la capitale, dont il est
pourtant éloigné d’une dizaine de kilomètres. La
petite ville est bâtie sur un plateau quelque peu
élevé au-dessus du fleuve. Les maisons, composées d’un
rez-de-chaussée surélevé, ne ressemblent en rien aux
tanières de Tchémoulpo. Elles regorgent de
marchandises, qui indiquent l’importance commerciale
de la cité, que nous traversons pour regagner la route
de Séoul.
Nous
voici maintenant au milieu de superbes jardins
maraîchers, où l’on cultive divers légumes,
particulièrement des choux gigantesques; de-ci de-là
sont des arbres à fruit; enfin autour de nous
s’étagent des collines boisées. Cette magnifique
végétation contraste agréablement avec le petit désert
que nous venons de traverser. Plus loin, nous
rencontrons une superbe allée de saules géants que
j’ai fort envie de suivre. Je dois y renoncer, ce
n’est pas le chemin, et la nuit arrive, amenant avec
elle la fermeture des portes de Séoul.
Après
avoir gravi le Mountoro-tsintari, nous pressons donc
nos montures. qui n’ont pu suivre notre Chinois, et je
commence à désespérer d’arriver à temps, quand nous
voyons brusquement dans la brume une porte monumentale
surmontée d’un pavillon genre chinois, et de longues
murailles profilant leurs créneaux dans le rouge du
soleil couchant, Bientôt nous passons sous l’immense
porche, les portes se referment sur nous: nous sommes
dans la ville.
Une
rue large comme l’avenue des Champs-Élysées s’ouvre
devant nous: elle est bordée de masures recouvertes de
chaume derrière lesquelles se dresse une plaine de
toitures en tuile: il me semble entrer dans un immense
village. Je marche au milieu d’une foule affairée, je
suis à demi aveuglé par la fumée, et pourtant je ne
vois aucune cheminée. C’est que les maisons coréennes
sont construites sur de petites voûtes en pierre
s’élevant d’environ trois pieds au-dessus du sol; le
feu se met à l’une des extrémités, et la fumée,
s’échappant de l’autre, asphyxie les passants, mais
réchauffe à son passage tout l’intérieur de la maison.
Les maisons sont bâties en moellons, toujours sans
étage et avec cette particularité que, sur la face
extérieure des murs, chaque pierre se trouve comme
sertie dans une corde qui en fait le tour. Cependant
les lanternes s’allument dans les boutiques.
Celles-ci, comme au Japon. n’ont ni devantures, ni
sièges, ni tables. On s’y assied par terre, à moins
que, vu l’exiguïté du local encombré, on ne fasse du
dehors ses acquisitions. Ajoutons que tous ces
magasins sont très mal tenus.
Bientôt
nous quittons la grande rue pour prendre d’étroites
ruelles, où sur mon petit cheval je domine de la tête
et des épaules le bord des toitures. Partout des
ruisseaux puants et profonds qu’il faut éviter. On les
traverse souvent sur les petits ponts, formés d’une
étroite pierre, où ma monture glisse à tout instant.
La nuit, de plus en plus sombre, voile à demi le
triste spectacle qui m’environne, quand nous arrivons
enfin à l’hôtel japonais. Des chants, des cris, des
rires qui partent de l’intérieur, m’annoncent qu’un
grand nombre de voyageurs y sont déjà installés. A
peine suis-je entré, qu’une charmante mousmé se
met à mes pieds, touche du front la terre et m’offre,
le plus gracieusement du monde, une minuscule tasse de
thé; je la prends en lui disant de faire préparer ma
chambre. Elle me répond qu’il n’y a plus de place;
j’insiste, elle me prend par la main et me fait
parcourir toutes les chambres en faisant glisser
successivement dans leurs rainures les châssis en bois
recouvert de papier qui les séparent, sans qu’aucun
des locataires paraisse prêter la moindre attention à
notre présence inattendue. Hélas! l’hôtel est plein.
Que faire, sinon m’adresser à notre consul? Mais
comment trouver sa demeure dans une ville de plus de
200 000 habitants? Heureusement la petite mousmé qui
m’a si bien accueilli est aussi intelligente qu’
avenante, et grâce à un vocabulaire
anglo-franco-japonais, elle me comprend et indique
l’adresse désirée aux palefreniers.
Je
suis si content que j’embrasserais la gentille mousmé;
avouons la vérité, je le fais, et elle en est si peu
fâchée qu’elle ne veut accepter aucune gratification
pour son aimable accueil, et m’aide même à monter à
cheval, accompagnant mon départ d’un brillant éclat de
rire argentin, tant tout cela lui semble amusant, le
baiser étant absolument inconnu au Japon. Nous
reprenons notre marche dans la nuit, et pendant près
de trois quart d’heures nous parcourons de nouveau
cette ville immense. Enfin, après avoir suivi un large
canal presque à sec et peu profond, nous le traversons
sur un pont admirablement dallé, mais sans parapets,
et arrivons à la légation de France. Des soldats
coréens m’entourent, je donne ma carte, et bientôt je
suis reçu de la façon la plus charmante par notre
éminent représentant M. Collin de Plancy.
J’avais
eu l’honncur de le voir à Paris la veille de son
départ, qui précéda le mien de deux mois, et il
m’accueille ici comme un vieil ami, m’offrant la plus
complète hospitalité. Il me prouve, en compagnie de
son aimable chancelier, M. Guérin, que je suis attendu
depuis longtemps avec impatience, en m’installant de
suite dans la chambre qu’on a préparée pour moi.
Quelques instants après, nous nous mettons à table.
Oh! la charmante, l’exquise, la bonne soirée! et qu’il
est doux aux antipodes de Paris de parler de la France
et des amis communs qu’on y a laissés! Nous sommes si
heureux d’être ainsi réunis et d’évoquer par la pensée
tout ce que nous aimons, que la nuit est fort avancée,
quand, par un énergique effort de notre volonté, nous
pouvons enfin nous séparer. Tel est le début de mon
voyage en Corée, beaucoup plus simple que je ne
l’avais pensé et se terminant sous le toit hospitalier
d’excellents amis.
Voici
comment est organisé chaque jour l’emploi de mon temps
à Séoul. M. Collin de Plancy a fait répandre le bruit
qu’un voyageur français achète des échantillons de
toutes les productions du pays, et se tient à la
légation tous les matins à la dispositions des
négociants. Aussi ceux-ci arrivent-ils de très bonne
heure et en grand nombre, munis de leurs marchandises,
que j’examine avec le plus grand soin au point de vue
de ma collection ethnographique coréenne, rejetant
impitoyablement tout ce qui vient de l’étranger. M.
Collin de Plancy est assez aimable pour mettre à ma
disposition quelques indigènes lettrés, ses
secrétaires, auxquels il apprend chaque jour le
français. Ceux-ci me donnent de nombreuses
explications sur tous les objets dont j’ignore
l’usage. Ils rectifient les prix, parfois
ultra-fantaisistes, des vendeurs, qui acceptent ou
refusent nos offres, sans que je perde mon temps en
marchandage et manque aucun achat, le commerçant me
rapportant le lendemain ce qu’il a refusé de céder la
veille.
Notre
déjeuner est agrémenté souvent de la présence de
quelques grands dignitaires, ministres ou mandarins
coréens, que je m’empresse de photographier, à leur
grande satisfaction, au moment de leur départ. Il a
lieu fort cérémonieusement, car, suivant les rites,
nous les accompagnons jusqu’à leurs palanquins,
composés d’une espèce de fauteuil sur lequel est jetée
une peau de léopard; ce siège est posé sur deux
longues perches qu’on soulève avec des bâtons
transversaux; au moment même où le mandarin s’assied
les nombreux porteurs poussent un cri guttural et
prolongé. Ils le renouvellent à la sortie et durant
tout le trajet, pour écarter les passants sur le
parcours du cortège, et à l’arrivée au yamen, pour en
faire ouvrir les portes, comme cela avait lieu à la
légation, prévenue ainsi à l’avance de la venue des
dignitaires coréens.
Dans
l’après-midi nous parcourons Séoul, en compagnie de
mes aimables hôtes et de quelques secrétaires lettrés,
entrant avec eux chez les commerçants pour y acheter
tout ce qui nous paraît offrir quelque intérêt
ethnographique. Nous faisons aussi visite à de grands
personnages officiels, européens ou indigènes. Ceux-ci
nous accueillent d’une façon charmante dans de
coquettes petites maisons sans étage, réduction du
yamen que j’ai décrit à Tchémoulpo. En avant sont les
pièces destinées aux réceptions, en arrière les
chambres des femmes, où nul ne pénètre que le mari,
enfin les communs sont disséminées dans un jardin
assez bien entretenu. On y pénètre après avoir passé
dans une petite cour d’entrée où se tiennent les
satellites, qui se font largement payer l’introduction
des quémandeurs et des marchands ayant quelque affaire
à proposer.
Dans
les maisons ordinaires, les pièces de réception sont
directement sur la rue, d’où l’on aperçoit ce qui se
passe dans l’intérieur, les portes étant généralement
ouvertes pendant la belle saison.
Nous
sommes également reçus à cœur ouvert par Mgr Blanc,
évêque de Corée, le Père Cotte et ses collègues. Ils
me font même don de divers objets trouvés dans les
fouilles qu’on exécutait en ce moment pour la
construction de l’église catholique. Le terrassement
en est déjà fait sur une éminence, où la cathédrale
dominera bientôt superbement la capitale. Je visite
aussi les bonnes sœurs arrivées par le bateau qui a
précédé le nôtre. Elles ont déjà ouvert une école et
recueilli une centaine de petits enfants des deux
sexes, qu’elles instruisent maternellement et qui
paraissent beaucoup les aimer. Comment en serait-il
autrement avec ces saintes femmes? L’une à consacré
plus de vingt-cinq ans de sa vie aux Missions
sénégalaises, et l’autre, charmante jeune fille d’une
rare beauté, vient de renoncer à toutes les joies du
monde pour embrasser son héroïque carrière. Elles sont
aidées par une jeune sœur chinoise, qui lutte avec
elles de sacrifices et de tendresse. Nous complétons
souvent notre journée en visitant quelques monuments,
puis nous rentrons pour le dîner, où, grâce à mes
aimablcs hôtes et à quelques attachés de légations
européennes invités, nous passons des soirées que je
compte parmi les plus charmantes de ma vie.
Ai-je
besoin de dire qu’on parlait souvent de
l’organisation, de la vie et des mœurs de la capitale?
C’est ainsi que Séoul est à la Corée ce que Paris est
à la France, car la centralisation y est identique et
domine, ici comme chez nous, tout le pays. Ce fut
seulement dans les premiers temps de la dynastie des
Ming en Chine que le roi de Kaoli, Litan, quitta
Khaï-Tcheu et s’établit à Séoul, séduit par sa
magnifique situation. En effet, au nord, la montagne
de Hoa-chan entoure la ville comme une formidable
armure; à l’est s’étend une chaîne dont chaque passage
était jadis gardé, tandis qu’au loin, à l’ouest, se
dessine le contour sinueux des côtes baignées par la
mer, et qu’au sud le Han-kang forme comme une
ceinture. Depuis cette époque Séoul est demeurée la
capitale du royaume. C’est de là que le roi gouverne
d’une façon absolue ses seize à dix-huit millions de
sujets, car il porte la triple couronne: grand-prêtre,
il officie pour son peuple; père de la nation, il
l’administre comme sa propre famille; enfin, gardien
de la sécurité de tous, il décide de la paix ou de la
guerre, et nul ne pourrait toucher, même
involontairement, à sa personne trois fois sainte sans
mériter la mort. Une telle vénération mêlée à tant
d’autorité amena bientôt les souverains à demeurer
absolument renfermés dans leur palais, au milieu de
femmes, de concubines et d’eunuques; ce sérail abusa
souvent de l’isolement royal pour pressurer le peuple
qui n’en adorait pas moins son roi, le sachant
complètement innocent de ses malheurs. Cet état de
choses se maintint jusqu’à et durant toute la minorité
du roi actuel. Le régent, homme aux antiques préjugés,
détestant tout ce qui est étranger: ordonna à cette
époque de sanglantes persécutions contre les chrétiens
du royaume. Il amena ainsi, par représailles, diverses
expéditions militaires de la Russie, de la France et
des États Unis. La situation extérieure
s’assombrissait chaque jour davantage pour la Corée,
lorsque arriva la majorité du roi actuel. Celui-ci,
l’esprit largement ouvert aux idées du progrès
moderne, comprit à quels dangers était exposé son
pays, et permit enfin l’accès de la Corée aux
étrangers, en contractant avec eux de nombreux traités
d’amitié, de paix et de commerce.
Si
la politique extérieure de la Corée était changée du
tout au tout, l’organisation générale du pays demeura
absolument la même; le roi supprima seulement son
sérail et commença la réorganisation de son armée à la
façon européenne. Mais l’admirable conseiller, le
conseiller de gauche et celui de droite, qui
surveillent et rendent compte au roi de l’ensemble de
l’administration, furent conservés. Il en fut de même
de toute l’organisation publique, ainsi subdivisée: le
ministère ou tribunal des rites, établi pour le
maintien des us et coutumes du royaume; le ministère
des offices et emplois, qui nomme à tous les postes
les hommes qui ont passé les examens nécessaires; le
tribunal des finances, chargé du dénombrement du
peuple et des impôts; le ministère de la guerre qui
s’occupe de l’armée; le tribunal des crimes, qui a la
surveillance des prétoires et veille à l’observation
des lois criminelles; enfin le ministère des travaux
publics, qui s’occupe, outre sa spécialité, de tout cc
qui regarde le commerce et l’ organisation des
cérémonies officielles. Voici maintenant le
fonctionnement pratique de cette administration: en
tête de chaque province est le gouverneur; à sa suite
viennent les chefs de districts, dont le nombre
s’élève à trois cent trente-deux, chiffre
correspondant aux jours de l’année coréenne, puis
viennent les mandarins à la tête des villes
importantes, et, après eux, les maires des petites
cités, villages ou bourgades. Autour de chacun de ces
dignitaires se groupe un certain nombre d’employés,
nobles, vétérans, satellites, gardiens de palais, de
temples et de monuments publics, espions, etc., qui à
des degrés divers, font partie de ce que nous appelons
la classe administrative. Parallèlement à cette
classe, la noblesse se subdivise de la façon suivante:
d’abord les nobles alliés à la famille royale, puis
les enfants de ceux qui ont aidé à fonder la dynastie
ou qui se sont illustrés dans les fonctions publiques.
Ils occupent eux-mêmes différents degrés, suivant le
rapprochement familial avec le roi, ou les services
qu’ils ont rendus à l’État. Mille privilèges leur
furent assurés, et le peuple, opprimé, se constitua en
corps de métiers pour pouvoir lutter contre eux et
même parfois contre les mandarins, comme nous le
verrons plus tard. Les chefs élus de ces corporations
jouirent bientôt d’une réelle influence; aussi cette
organisation fut-elle adoptée par toutes les classes
sociales, dont voici l’ordre hiérarchique: lettrés,
bonzes, moines, cultivateurs, artisans, marchands,
portefaix, sorciers, musiciens, danseuses, comédiens,
mendiants, esclaves; puis la classe, abjecte pour les
Coréens, des tueurs de bœufs et des tanneurs.
Tout
homme, à l’exception de ceux des dernières classes,
peut, en Corée, se présenter aux concours qui ouvrent
seuls l’accès aux fonctions publiques. Les examens
supérieurs sont basés sur la connaissance de la langue
et des caractères chinois, la philosophie, la poésie,
l’histoire. En somme ils sont identiques comme
matières aux concours qu’on passe en Chine, mais
inférieurs comme valeur réelle. Ils se divisent en
trois degrés, donnant des titres littraires
correspondant chez nous à bachelier, licencié,
docteur. Malheureusement, à l’inverse du Céleste
Empire, on n’obtient des fonctions publiques qu’en
rapport avec sa position sociale, sans qu’on puisse,
pour ainsi dire, s’élever au-dessus; aussi, les plus
hautes fonctions étant remplies uniquement par la
noblesse, la plupart des gens de la classe moyenne
préfèrent-ils passer les examens militaires, délaissés
par l’aristocratie et qui n’exigent que les
connaissances relatives à l’armée et une simple
composition littéraire, ou les concours scientifiques
spéciaux, qui permettent d’entrer soit à l’école des
langues, d’où l’on sort interprète, drogman, etc.,
soit àux écoles de droit, des chartes, de médecine, de
calcul, dit de l’Horloge, de dessin et de musique, qui
ouvrent particulièrement des portes dans la Maison du
roi. Donc on peut dire qu’en Corée l’instruction mène
seule aux honneurs, et qu’elle est reconnue d’une
telle nécessité par l’État qu’une loi formelle déclare
que tout gentilhomme qui n’a pas lui-même, et dont
l’aïeul et le père n’ont pas occupé de fonctions
publiques faute d’avoir pu passer les examens est
absolument déchu de sa noblesse; c’est un heureux
correctif à la loi qui empêche d’occuper des fonctions
supérieures à la classe à laquelle on appartient;
telle est I’ organisation sociale et administrative de
la vie en Corée.
Avant
de parler du Séoul monumental, disons quelques mots de
ses environs. Vers la porte du Sud se trouve
l’emplacement du lieu des exécutions. On y voit épars
les ossements des criminels, et quelquefois leurs
corps décapités, non loin desquels se trouve la tête.
Ils sont laissés là comme exemple au peuple durant
trois jours, au bout desquels les parents ont le droit
de les inhumer.
Plus
loin, perdus dans la campagne et protégés par le
fleuve Han-niang, se trouvent quelques tombeaux royaux
placés dans des sites remarquables, enfin de-ci de-là
sont de nombreux greniers d’abondance destinés à
empêcher la disette en cas de mauvaise récolte ou de
guerre d’envahissement. Au nord, vers l’emplacement de
l’ancienne capitale, se trouve, chose rare en Corée,
un pont de pierre de vingt et un piliers, recouvert
d’un tablier en marbre. Près de là une pagode en
pierre rappelle d’importants événements historiques,
et une stèle porte en caractères chinois sur sa face
nord et en caractères mandchoux sur sa face sud, une
inscription immortalisant l’établissement par
l’empereur de Chine du roi qui a élevé cet édicule,
sur une gigantesque tortue de granit de 12 pieds de
long, sur 7 de large et 3 de hauteur. Enfin quatre
forts situés à quelques kilomètres de Séoul, à
Hang-hoa, Kais-yeng, Koang-tiyou et Syou-ouen,
défendent les approches de la campagne suburbaine, qui
est admirablement cultivée malgré son sol montagncux.
Jetons
maintenant
un coup d’ œil panoramique sur la capitale de la
Corée. Si nous montons sur quelque éminence centrale,
nous jouirons de la magnifique vue des montagnes
coniques couvertes de verdure qui l’environnent; les
plus élevés sont situées au nord et au sud. En maints
endroits on voit se profiler les murailles crénelées
qui entourent Séoul dans leur immense circonférence.
Elles suivent, comme en Chine, les sinuosités des
collines et sont percées de-ci de-là d’un grand nombre
de portes monumentales. Les deux plus importantes ont
un double étage à la façon chinoise et sont d’un grand
caractère architectural: l’une, par laquelle je suis
entré, est située à l’ouest, l’autre est à l’est et
précédée d’une enceinte quadrilatère crénelée, ayant
une petite entrée sur le nord. De ce côté de la ville
s’étend, à travers les montagnes, une deuxième
enceinte fortifiée, pouvant servir de camp retranché.
Séoul
est traversé de l’ouest à l’est par un large canal
principal portant au fleuve l’eau de toutes les
petites rivières qui descendent des montagnes et
forment une multitude de petits cours d’eau
perpendiculaires au Canal Central. Parallèlement à
celui-ci s’étend une large voie, ainsi que trois
autres plus étroites: toutes quatre sont coupées à
angle droit par un grand nombre de rues, dont les
principales se dirigent vers les anciens palais royaux
et le temple de Confucius au nord de la ville. Enfin
une autre rue fort importante part de la porte du
Sud-Est et rejoint la voie centrale en formant un arc
régulier. Le reste de la ville est composé d’un dédale
énorme de ruelles et d’impasses de toute sorte, qui
communiquent entre elles, soit directement, soit par
de nombreux ponts en dos d’âne et sans parapet,
traversant ruisseaux, rivières et canaux torrentueux
ou à sec suivant les saisons.
Les
grandes voies, comme à Pékin, sont obstruées par une
multitude d’échoppes, la plupart en bois recouvert de
chaume, où de nombreux marchands font leur trafic
presque en plein air. Quand le roi sort, toutes ces
constructions sont démolies, comme en Chine pour le
passage de l’empereur. La voie, redevenue large de
plus de 60 mètres et bordée par des maisons
construites en pierre, reprend alors son caractère
d’artère principale.
La
capitale se subdivise en plusieurs quartiers, parmi
lesquels les anciens et le nouveau palais royal,
complètement entourés de murs, forment avec leurs
portes monumentales comme des villes dans la ville. Le
quartier des nobles se distingue par ses maisons
élégantes recouvertes de tuiles et ses beaux jardins
clos de murs très bas: aussi est-il défendu, de par la
loi, sous les peines les plus graves, de regarder chez
ses voisins; on doit même les prévenir pour les
réparations à faire aux toitures. Ce règlement de
police s’applique à toute la ville. Les industriels et
les commerçants se réunissent généralement par
profession: c’est ainsi qu’on trouve la rue des
Tissus, des Meubles, de la Poterie, le quai du Fer, du
Cuivre, de la Peausserie, la place du Poisson, de la
Boucherie, etc. Enfin les Japonais ont aussi leur
centre dont ils font seuls la police; il en est de
même pour les Chinois, près desquels se sont groupées
presque toutes les légations européennes, résidant,
pour la plupart, dans d’élégantes constructions
coréennes, aménagées à nos usages. Quant au quartier
suburbain, ses constructions rappellent les misérables
chaumières de Tchémoulpo.
Outre
ce dont nous venons de parler, la capitale possède des
écoles spéciales pour les langues étrangères, les
beaux-arts, l’astronomie, la médecine, enfin un
hôpital et un grand nombre d’autres établissements
publics, organisés d’une façon tout à fait primitive.
Quelques
casernes
sont bâties non loin des murailles intérieures. Au
centre de la ville, dans le jardin d’une maison
particulière, se dresse une pagode en pierre de 25
pieds de hauteur, formée seulement de deux masses de
granit blanc auquel le temps a enlevé sa couleur. Elle
est divisée sculpturalement en huit étages, qui
typifient le ciel bouddhique en représentant les âges
successifs par lesquels l’âme doit passer pour arriver
à sa purification complète. Le délaissement du
bouddhisme explique seul l’enfouissement de ce joli
échantillon d’architecture indochine-coréenne. C’est
que le confucianisme est véritablement la doctrine
religieuse dominante, aussi a-t-on élevé au grand
philosophe chinois un magnifique temple situé au
nord-est de Séoul. Il est abrité de tous côtés par les
montagnes et protégé par deux rivières qui l’entourent
en se rejoignant vers le sud. Cet immense
établissement religieux possède, outre le sanctuaire
de pur style chinois dédié à Confucius et aux
ancêtres, une vingtaine de bâtiments, dont
quelques-uns fort spacieux servent à abriter de
nombreux lettrés coréens, qui viennent y poursuivre le
cours de hautes études philosophiques. On sent que
c’est le point où gît la véritable force
intellectuelle du pays et d’où elle se répand pour
diriger l’administration, la famille, les mœurs de la
Corée. Pour terminer l’énumération des édifices
religieux, il ne nous reste plus qu’à parler des
divers temples élevés dans les montagnes voisines de
Séoul. La plupart de ceux-ci, comme aussi les palais
royaux, yamen et autres endroits où réside une haute
autorité, sont précédés d’un portique en bois dont la
hauteur est de 30 à 40 pieds et la largeur de 20 au
plus. Il se compose de deux poutres perpendiculaires
et réunies à leur sommet par deux traverses parallèles
en bois, sur lesquelles sont clouées à angle droit de
nombreuses flèches rouges, la pointe dirigée vers le
ciel. On donne le nom de Hong Sal-Moun [Hongsalmun],
c’est-à-dire, «porte aux flèches rouges», à cet
étrange et svelte édifice que je crois d’origine
tartare et non japonaise. Après avoir franchi
l’élégant portique, nous trouvons au milieu d’un
jardin la pagode bouddhiste. Elle est construite dans
le goût chinois. mais d’un style assagi par une
certaine lourdeur dans les lignes d’architecture
générale et une plus grande sobriété dans les détails.
Nous pénétrons dans le temple et nous y trouvons des
Bouddhas en pierre, en bronze, en bois, etc. Ils se
distinguent de ceux des autres pays par une tresse de
cheveux ramenée au sommet de la tête, où elle se
dresse comme une petite corne; nous en expliquerons
plus tard l’origine. Je me suis procuré plusieurs de
ces Bouddhas et j’ai trouvé, dans l’intérieur de
chacun d’eux, une petite boîte en cuivre qui contenait
cinq pierres plus ou moins précieuses, figurant les
viscères du Dieu. Il y avait aussi des parfums,
diverses graines, de nombreuses prières bouddhiques en
caractères chinois, coréens, tibétains, etc.,
imprimées sur des feuilles volantes; parfois même des
ouvrages entiers. J’en citerai particulièrement un de
40 centimètres sur 25, en papier noir avec caractères
et dessins en or d’une rare finesse d’exécution. Enfin
j’y ai lu, écrit à la main, le nom de l’artiste, des
donateurs et du temple auquel il avait été offert. Les
inscriptions qui décorent les édifices bouddhiques
sont presque toujours en caractères chinois, peints
sur des panneaux de bois ou sur des kakémonos en
papier, en soie, etc., toujours en couleurs et
quelquefois dorés. On y admire parfois de grands
panneaux décoratifs, de plusieurs mètres carrés,
recouverts d’admirables peintures, représentant des
scènes bouddhiques d’une étrange et brillante
exécution, souvent très artistique comme dessin et
coloris.
Les
plus beaux spécimens architecturaux de Séoul sont
certainement les palais royaux. Je n’ai pu visiter
celui qu’habite le roi, par suite du deuil où il était
plongé au moment de mon séjour, mais j’en ai vu deux
autres beaucoup plus anciens et peut-être plus
intéressants, quoiqu’ils aient été détruits en partie
pendant les dernières émeutes qui ensanglantèrent la
capitale. C’est en compagnie de Mgr Blanc, des Pères
et de M. Guérin, qui ne les avaient pas encore
visités, que nous faisons cette intéressante
promenade. M. Collin de Plancy, qui nous a obtenu la
permission, se trouve, malheureusement pour nous,
retenu ce jour-là par les affaires de la Légation.
L’entrée des palais est précédée d’une porte
monumentale. Elle rappelle comme architecture
l’immense arc de triomphe en pierre, à trois
ouvertures et à plein cintre, surmonté d’une double
toiture, légèrement recourbée, du tombeau des Mings,
aux environs de Pékin. Sur de hauts piédestaux deux
lions de pierre la gardent extérieurement.
Nous
pénétrons dans une immense cour d’honneur, à
l’extrémité de laquelle se dresse le grand palais de
réception. C’est un vaste édifice tout en bois,
construit sur une double plateforme en maçonnerie qui
le surélève. On arrive, par un escalier de quelques
marches en marbre blanc, au vaste péristyle qu’abrite
une double toiture aux tuiles diversement émaillées.
Elles sont soutenues par des poutres en saillie,
terminées par des têtes de dragons coloriés;
l’ensemble est d’un aspect grandiose. Le centre du
monument forme une vaste salle que soutiennent
d’énormes colonnes, troncs d’arbres plusieurs fois
séculaires, sur lesquels repose toute la charpente. Le
fond de cette pièce est orné à l’intérieur de
peintures murales dans le goût japonais, mais beaucoup
plus violent de couleurs et d’une intéressante naïveté
d’exécution. Elles représentent des paysages
montagneux qu’éclaire le soleil, représenté par un
cercle blanc entouré d’une double circonférence rouge,
ou la lune, figurée de la même façon par les mêmes
couleurs contrastantes. Au milieu de cette curieuse
décoration, qui ne manque pas de grandeur, s’élève
l’estrade du roi, que domine, suspendu dans l’air, un
énorme phénix en bois doré, aux pieds duquel se
développe un superbe paravent en bois à jours,
merveilleusement sculpté. Du haut de ce trône le roi
apercevait, toute la façade de l’édifice étant ouverte
à cet effet, la cour d’honneur où se tenait la foule
des mandarins, des nobles, etc., qui forment les huit
castes de la société coréenne. Les représentants de
chacune d’elles, en costume spécial, se plaçaient,
selon leur rang, en face du trône, en s’alignant aux
seize bornes de marbre blanc qui séparaient les
diverses classes sociales. Tel était le cérémonial des
audiences solennelles.
Plus
loin, nous entrons par une petite porte élégante dans
un jardin où nous admirons un nouveau palais du même
style que le premier et où se trouvent les
appartements qu’occupait le roi. Ils sont spacieux et
présentent dans de moindres dimensions des décorations
analogues à celles dont nous venons de parler. La
vaste salle centrale est réservée pour les cérémonies
funèbres, qui ont lieu à la mort de chaque roi. Le
corps du défunt, étendu dans un superbe catafalque, y
séjourne sous un large dais jusqu’à entière
dissolution, et les produits de la décomposition
s’écoulent dans le sol par une ouverture ménagée
au-dessous du cadavre.
Nous
visitons ensuite le palais de la reine. Il se compose
d’une suite de kiosques du goût chinois le plus
gracieux. Partout s’élèvent de coquets pavillons aux
toitures relevées. Tous sont unis par de légères
passerelles élégamment suspendues. L’ensemble est du
plus charmant effet. Du salon de la reine, décoré de
délicates peintures et admirablement éclairé, on jouit
d’une vue superbe sur les pittoresques et montagneux
environs de Séoul, tandis qu’au premier plan
s’étendent des jardins abandonnés aujourd’hui, mais
qui devaient être délicieux d’après les restes des
berceaux agrestes, des bancs, vases et jardinières en
pierre, où l’on retrouve les marques de toute
l’exquise fantaisie qui a présidé à l’érection de ce
palais. Les apparternents des dames de la cour avaient
été quelque peu sacrifiés aux effets d’architecture
extérieure, car ils consistaient en affreuses petites
chambres pas aérées, et encore plus mal éclairées.
Enfin un vaste bâtiment, consacré à la chambre
mortuaire de la reine, est en tout semblable à celui
du roi, mais moins grandiose. Nous terminons cette
intéressante promenade en passant à travers des cours
encombrées de gravats de toutes sortes, de nomhreux
chardons bulbeux et de toute une flore sauvage, pour
arriver enfin à des bains inachevés en marbre blanc,
d’une superbe ordonnance que le roi était en train de
se faire construire, quand une révolution le força à
abandonner ce splendide palais.
Nous
parcourons ensuite les nombreuses dépendances
qu’habitaient les soldats de service au château et les
demeures des fonctionnaires. Tous occupaient des
rez-de-chaussée fort peu intéressants à visiter, à
l’exception du petit bâtiment où se trouvait la
clepsydre en bronze qui indiquait les heures.
Celles-ci sont désignées en Corée par l’occupation
habituelle qu’elles représentent, par exemple: l’heure
du déjeuner, du dîner, etc. Auprès de l’horloge
hydraulique se trouve la petite chambre de l’astronome
qui était chargé de l’entretenir et de faire chaque
jour des observations sur une petite tour carrée
d’environ 6 mètres de hauteur. Elle est envahie en ce
moment par nos lettrés coréens; de là-haut, dans leurs
blancs vêtements, ils évoquent à mon esprit le
souvenir de quelque mystère antique. Quant à nos boys,
ils se sont dispersés dans un immense champ de navets
et le dévalisent à qui mieux mieux. Nous les rappelons
énergiquement aux bienséances, auxquelles ils
finissent par se conformer tout en mangeant le fruit
de leur larcin.
Nous
sortons enfin du palais: la nuit est venue, et une
partie de mes très aimables compagnons me quittent
pour rentrer chez eux. Cependant, tout autour de nous,
sur les montagnes, s’allument de grands feux dont le
lumineux signal, se renouvelant de cime en cime, va
dire aux extrémités de la Corée que la paix règne dans
la capitale, qui apprend par le retour des mêmes
courriers que tout le royaume est tranquille.
Nous
rentrons à la Légation, où l’on m’explique durant le
dîner le code des signaux lumineux en Corée. Quatre
feux sont allumés en temps de paix, c’est-à-dire un
pour deux provinces. En temps de guerre, le signal est
plus compliqué. Un second feu, placé à droite ou à
gauche du premier, indique la province menacée. Deux
feux quand l’ennemi traverse ou débarque; trois feux
quand il est entré dans le pays, et quatre feux quand
les combats ont commencé. Outre cette télégraphie
lumineuse, le gouvernement coréen emploie tout un
service de postes dont les relais sont uniquement
consacrés au service de l’État. Peu après la signature
des traités, il avait fait exécuter au Japon un très
beau matériel pour la fabrication des timbres
d’affranchissement, malheureusement ce matériel fut
détruit pendant les derniers troubles qui éclatèrent à
Séoul, où j’eus la plus grande peine à me procurer
quelques types. En revanche le télégraphe relie par
plusieurs lignes la Corée à ses voisins, et commence
même à étendre son réseau sur le pays. On trouve à
Séoul une loterie royale. Les billets, de 20
centimètres carrés, sont imprimés en bleu et
recouverts de nombreux cachets multicolores;
l’administration livre seulement la moitié à
l’acheteur et garde l’autre pour son contrôle. Il
existe également un calendrier national, qui eut sa
célébrité dans les temps anciens. Il fut même préféré
au calendrier chinois par les Japonais. Enfin un
journal officiel paraît chaque jour à Séoul. Pendant
longtemps il fut imprimé, mais on ne le publie plus
maintenant qu’à l’état manuscrit. Je donne ici un
extrait des numéros du 5 et 6 octobre 1888.
«L’assistant
compositeur
de l’académie de la haute littérature Ming-Tchong-Sik,
ayant refusé sa charge pour la première fois, le roi
lui a donné congé.
-
Le directeur du bureau des historiographes
Y-Youn-Sing, ayant refusé sa charge pour la troisième
fois, le roi lui a changé sa charge.
-
Le Ministère des rites a fait un rapport au roi où il
est dit:
Quand
on adressera des félicitations à la reine lors de
l’anniversaire de sa naissance, le 25 de cette lune,
nous voulons faire les félicitations comme par le
passé. Qu’en pensez-vous? Réponse du roi: Il vaut
mieux n’en point faire.
-
Au jour susdit le prince héritier félicitera-t-il la
reine?
-
Décret: Il vaut mieux qu’il ne le fasse pas.
-
La haute cour de justice a fait un rapport au roi où
il est dit Nous avons arrêté You-Tchin-Pil et
Tchong-Ym-Siang.
-
Décret: Nommez le sous-secrétaire du bureau chargé des
rapports directs avec la cour de Pékin
Youn-Kiong-Tchou, comme secrétaire de première classe
du bureau des censeurs».
Ainsi
chaque soir je complétais mes observations de la
journée par une multitude de renseignements que me
donnaient mes très aimables hôtes.
C’est
que M. Collin de Plancy est bien l’homme le plus
aimable et l’ami le plus dévoué que je connaisse, car
son cœur a toutes les délicatesses, et son esprit est
des plus distingués. C’est certainement, parmi les
nombreux diplomates que j’ai eu l’honneur de connaître
dans mes voyages, un de nos agents les plus
remarquables. J’ai eu l’avantage, durant mon séjour
chez lui, d’assister à quelques-uns des incidents
politiques qui surgissent souvent dans ces pays neufs,
et j’ai toujours trouvé chez notre représentant une
justesse de coup d’œil, une rapidité d’exécution, et
une sûreté de main qui lui font le plus grand honneur.
Nul mieux que lui ne sait asseoir avec plus de
gracieuse droiture la partie adverse sur le fagot
d’épines, et je dois ajouter qu’il est admirablement
secondé par son chancelier, M. Guérin. Telle fut,
grâce à ces excellents amis, la charmante organisation
de ma vie à Séoul.