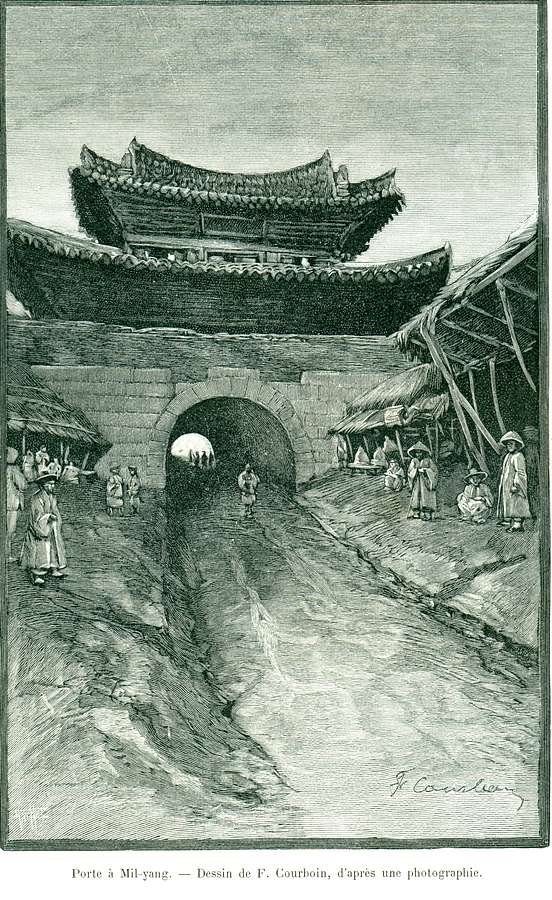
Voyage en Corée
par
Charles Varat
Explorateur chargé de mission ethnographique
par le ministère de l'Instruction publique
1888-1889 — texte et dessins inédits
Le Tour du
Monde LXIII, 1892 Premier Semestre.
Paris : Librairie Hachette et Cie.
Pages 289-368
Section IV.
[Click here for the other sections: Section I,
Section II,
Section III,
Section V.]
Gravures (all)
[Click here for the English
translation: Section
One; Section
Two; Section
Three; Section
Four; Section
Five.] Engravings
(all)
Ascension de la
crête de la chaîne centrale. - Grande muraille et
porte fortifiée. - Échange de monnaie. - Descente du
Song-na-san, - Une place forte. - Les brigands. -
Exploration purement scientifique et expédition
militaire. - Cotonniers. - Convoyeur. Mât de lettré. -
A vol d’oiseau. - Fleuves et rivières. -Pêche. -
Anthropologie infantile. - Poulaillers. - Campement
forain. - Mort-vivant. - Monuments commémoratifs. -
Une auberge suburbaine. - Taikou. - Réception du
gouverneur. - La ville. - Une fête coréenne. - Le
départ. - Singulier effet de trompettes. - Tchang-to.
- La fleur des champs brille à ma boutonnière! - La
pluie. - Mil-yang architectural.
Après deux jours
de montée à travers les contreforts de la chaîne
centrale, nous atteignons enfin le carrefour de la
croix, le King-pang-tcha-nadri, village situé à la
base du dernier col du Song-na-san. Là on me dit qu’il
faut faire décharger les chevaux et louer des hommes
pour porter à dos notre bagage, tant cette dernière
crête est difficile à franchir, par suite de la
raideur des pentes et des effroyables rochers qui les
couvrent. Je m’oppose d’abord à cette désorganisation
de la caravane. Mais mon interprète a de terribles
renseignements au sujet de ce passage: jamais,
m’assure-t-il, mandarin ne l’a franchi autrement qu’en
palanquin, et si je fais la route à pied, je perdrai
une grande partie de mon prestige aux yeux de mes
hommes, en privant de leur rémunération les habitants
du village, dont le portage est, pour ainsi dire,
l’unique ressource.
Je
dois donc monter dans une chaise à porteurs des plus
rustiques; dix hommes la soulèvent, nous commençons
l’ascension. A peine parti, je comprends l’insistance
de Ni, en le voyant installé lui-même dans un
palanquin. Son rêve, depuis le commencement du voyage,
est enfin réalisé. Il faut pourtant reconnaître que
jamais nous n’avons eu une route aussi épouvantable.
Je m’assieds d’abord à l’européenne et laisse pendre
mes jambes hors de la chaise, mais je dois bientôt les
rentrer dans l’intérieur et les croiser sous moi à la
coréenne, pour qu’elles ne soient pas brisées par les
nombreuses roches au-dessus desquelles mes porteurs
m’entraînent rapidement. Eux-mêmes évitent les rochers
plus élevés qui les menacent de leurs aspérités, en
émergeant de terre sous des formes aussi bizarres que
dangereuses. Aussi les malheureux en m’emportant
soufflent, geignent et ruissellent de sueur,
quoiqu’ils soient relevés toutes les cinq minutes par
d’autres hommes. Il en est ainsi presque jusqu’au
sommet, où l’aspect de ce torrent de rochers se
modifie peu à peu; leur nombre diminue, quelques
arbres disséminés apparaissent; devenus bientôt plus
nombreux, ils commencent à nous abriter de leur ombre,
et le sol, s’aplanissant enfin, permet de marcher. Je
saute de mon palanquin, contrarié de tout le mal que
j’ai donné, mais je ris de mon pauvre Ni, contraint de
descendre en me voyant à terre, quoiqu’il eût préféré
de beaucoup continuer la route dans sa chaise. A
mesure que nous sommes montés, le paysage est devenu
plus charmant et la flore s’est modifiée complètement.
Les sapins, les mélèzes ont disparu pour faire place à
la merveilleuse végétation arborescente du Japon. Nous
sommes à l’automne; jamais je n’ai vu la nature parée
de plus riches couleurs, passant du vert foncé au
jaune d’or, par un mélange de tons de l’effet le plus
heureux. C’est ainsi que nous atteignons la porte
frontière de Moun-kiang; le pavillon qui la surmonte
est décoré de peintures, et elle est fortifiée à la
chinoise comme la longue muraille, suivant
capricieusement la crête du Song-na-san, qui séparait
autrefois deux royaumes puissants, aujourd’hui
provinces coréennes. Là est établie une auberge, où il
faut changer notre monnaie, car elle n’a pas cours de
l’autre côté de la chaîne centrale. Contre l 350
sapèques de Séoul on veut bien m’en donner 650 de
Taïkou. Je m’étonne d’abord de cet écart énorme, mais
on m’affirme que les dépenses de la vie sont deux fois
moins élevées de ce côté de la montagne. Fait étrange:
je laisse des sapèques coréennes et l’on m’en remet de
chinoises; elles sont du reste de même forme et ne
diffèrent les unes des autres que par leur volume plus
considérable et leurs inscriptions. Mon interprète,
qui est en même temps mon ministre des finances, opère
cet échange, pendant que nos chevaux et nos hommes
arrivent un à un, soufflant, éclopés, harassés de
fatigue. Je fais rafraîchir tous les ascensionnistes;
deux heures après, on recharge les bagages sur nos
bêtes et la caravane se reforme. Si la montée a été
pénible, autant est charmante la descente de l’autre
côté du col; c’est, en plus beau encore, la suite de
la superbe forêt que j’ai décrite tout à l’heure.
Partout
des arbres centenaires, particulièrement des cèdres,
étendent au-dessus de nos têtes leurs épaisses
ramures, qui laissent passer entre leurs branches
mordorées un jour adouci donnant à tout je ne sais
quel aspect mystérieux. Le grand silence de la forêt
est troublé seulement par le cri de quelque oiseau
effarouché ou le bruit que fait à travers les feuilles
mortes un fauve s’enfuyant à mon approche. Je descends
ainsi seul à pied la montagne, bien avant la caravane
fatiguée, et m’enivre de l’exquise senteur des bois,
jouissant du charme infini de l’entière solitude dans
cette forêt séculaire si pleine de fraîcheur.
J’atteins ainsi une pente ravinée où s’élève sur ma
droite une haute muraille calcaire, j’en admire les
assises gigantesques qui se poursuivent verticalement
en un plan d’une pureté admirable, hérissé pourtant çà
et là par quelques arbustes aux vives couleurs,
accrochés aux interstices produits par la pluie ou la
foudre.
J’arrive
bientôt à une vaste enceinte formée par des murs
crénelés, habitation de quelque ancien seigneur, ou
plutôt ville forteresse frontière. Depuis longtemps
abandonnée et aujourd’hui en ruine, il en reste
seulement un superbe squelette architectural. Nous
descendons encore, et le ciel est plus bleu, l’air
plus chaud, la flore plus variée, car de ce côté de la
montagne arrivent directement les brises tièdes du
Pacifique. Puis nous retombons bientôt dans une petite
chaîne de collines secondaires, la plupart dénudées et
d’un aspect sablonneux, et coniques. Nous les laissons
à droite et à gauche; on les nomme Ching-Chang-tong ou
«montagnes des voleurs». Elles servent en ce moment de
refuge à des brigands qui ont profité d’un
commencement de famine pour s’organiser en bandes.
C’est en suivant le milieu de la vallée, de mieux en
mieux cultivée, que nous arrivons avec la nuit dans la
petite ville de Ma-pouang où nous devons coucher. Au
moment de prendre mon repas du soir, j’entends au
loin, chanté par des voix puissantes, je ne sais quel
hymne coréen d’un caractère provocant et guerrier.
Bientôt le chœur se rapproche, puis cesse, pour
recommencer à la porte même de l’auberge. Je sors et
vois à ma grande surprise tous les chanteurs armés
jusqu’aux dents; une partie des habitants de la
localité, me dit-on, se réunit en armes et chante
ainsi toute la nuit pour prévenir les bandits qui
ravagent le pays que le village veille et est prêt à
se défendre. En dépit des fatigues de la journée, je
dors mal, réveillé cent fois par cette lugubre mélopée
accompagnée de tam-tams et de cymbales; il en est de
même tous les soirs suivants, par suite de la terreur
qu’inspirent les brigands. Chose étrange! nous nous
habituons bientôt à ce concert nocturne et continuons
notre voyage sans plus nous préoccuper d’un état de
chose auquel nous ne pouvons rien, une caravane
n’étant jamais attaquée que par des bandes mieux
armées ou en nombre de dix fois plus considérable. Je
mets donc tout mon système défensif dans la rapidité
de nos mouvements, car je compte sur la surprise
causée par notre arrivée inattendue et repars avant
qu’on n’ait rien pu machiner contre nous. Ce sont là,
je crois, les meilleures conditions de réussite pour
traverser un pays inconnu. Car l’explorateur
scientifique, messager de paix et de progrès, ne doit
porter des armes apparentes que dans un pays où,
chacun en ayant, leur absence le mettrait aux yeux de
tous dans une réelle infériorité. Dans tout autre cas,
un arsenal visible est une véritable provocation. Tels
sont les procédés que j’ai employés partout et dont je
me suis toujours admirablement trouvé. Comme vous le
voyez, cher lecteur, tout cela est d’une simplicité
enfantine.
Il
est bien entendu que je ne parle pas des explorations
militaires; celles-ci présentent tous les avantages,
mais aussi tous les dangers de la guerre. Combien
d’entre nous y ont succombé! Pour ne citer que la
dernière victime, je nommerai l’infortuné Crampel,
dont la mort inattendue a douloureusement frappé le
cœur de tous. Hélas! pourquoi faut-il que moi, qui
l’aimais tant, je jette de si loin quelques fleurs sur
sa tombe ignorée, en rappelant quelle cruelle perte
c’est pour la France que celle de cet homme énergique,
à l’esprit si distingué et au cœur si délicat!
Pourtant je dirai de lui et de tous ceux qui sont
morts là-bas martyrs de la science: pleurons-les,
consolons les leurs, mais ne les plaignons pas
eux-mêmes, car il est beau de mourir pour le progrès
de l’humanité.
Depuis
que nous avons quitté la chaîne centrale en dirigeant
nos pas vers Taïkou, la capitale du Kyeng-syang-to par
Sai-ouen, Oul-mori, Poul-tcheouen pour entrer dans la
vallée de Youg-san-tong, le paysage est bien changé:
maintenant de vastes champs de cotonniers s’étendent
de tous côtés autour de nous. Malheureusement la
récolte est faite et il ne reste plus sur les arbustes
moissonnés que de rares flocons oubliés, mouchetant la
plaine de leur blancheur neigeuse et resplendissant
aux rayons du soleil, dans leur multiple isolement.
Tout ce tableau est exquis, car le temps est splendide
et je connais peu de pays où l’atmosphère soit plus
pure, plus transparente, plus lumineuse qu’en Corée.
Nous ne voyons plus les femmes se livrer à la récolte
de l’orge ou du riz: elles s’occupent uniquement ici
des différentes opérations que l’on fait subir au
coton avant de le transformer en tissu. La route est
animée par de nombreux Coréens qui portent sur leurs
dos de lourdes balles de coton. Ces convoyeurs, par
l’entremise desquels se font tous les transports, à
cause de l’état lamentable des routes, forment une
vaste confrérie; ils s’administrent, se jugent entre
eux et échappent ainsi à la juridiction des mandarins;
si ceux-ci les inquiètent, ils partent immédiatement
pour un autre pays: c’est leur manière de faire grève,
et ils ne tardent pas à être rappelés, vu
l’impossibilité où l’on se trouve de se passer d’eux.
Tout
ceci est éminemment conforme aux grandes associations
dites artèles,
qu’on rencontre fréquemment en Sibérie et dans la
Russie septentrionale. On dit que les mœurs y laissent
à désirer; je crois le contraire, les femmes de ces
convoyeurs étant fort respectées, ils punissent de
mort l’adultère, sont très robustes, travailleurs et
gais, se rangent respectueusement au passage de tout
mandarin ou personnage officiel, et jouissent,
intermédiaires indispensables de tout le commerce
intérieur de la Corée, d’une réputation de haute
probité. Aussi plus j’avance dans le pays, plus je me
prends à aimer ce peuple si courageux, si industrieux,
si honnête, en même temps doué de toutes les vertus
familiales. En passant par Sol-pay-ky, Pou-tché-dangy,
Tol-ki, Yetchon, Tol-ouen, Kain-mal et Ko-tchi, on
rencontre parfois, à l’entrée des petites villes, un
mât d’une dizaine de mètres surmonté d’un énorme
dragon en bois bizarrement colorié, qui de loin semble
voler dans les airs. Pour empêcher le vent de
l’abattre, quatre cordes, partant du sommet du mât,
sont fixées au sol, où elles forment des angles égaux.
Les habitants érigent eux-mêmes ce singulier trophée à
l’entrée de leur cité quand ils ont l’honneur d’avoir
parmi leurs concitoyens un lettré de première classe.
Les gens du peuple ont une telle confiance dans les
lumières de ceux qui ont passé leurs examens, que j’ai
vu, au cours d’une discussion en plein champ, des
Coréens prendre pour arbitre de leurs différents un
simple lettré et se soumettre à son jugement Ceci
montre en quelle haute estime l’instruction est tenue
en Corée, où presque tout le monde sait écrire, et
quels rapides progrès fera ce peuple lorsqu’il sera au
courant de nos sciences européennes. Nous pénétrons
dans la vallée de Haing-tong, nous dirigeant vers
Han-king-kepy.
Souvent
dans les villages mon regard est arrêté par une perche
à laquelle est suspendu un énorme panier d’osier, de 3
mètres de long, de la forme d’un cigare; au milieu est
une ouverture dans laquelle les poules viennent
chercher un refuge contre les nombreux renards que
n’effrayent nullement la superbe queue de plus d’un
mètre du coq coréen, ni les deux énormes disques
blancs qui, comme des pains à cacheter, entourent les
yeux des poules et leur donnent un air de famille avec
leur sœurs cochinchinoises. La chair exquise de ces
volailles a remplacé souvent pour moi la viande de
boucherie, et leurs œufs ont complété maintes fois
l’ordinaire de mes repas.
La
route qui doit nous conduire à Taïkou est encore bien
longue: craignant donc d’abuser de la patience du
lecteur, nous allons en faire une partie à vol
d’oiseau, el cela se trouvera d’autant mieux qu’il va
nous falloir franchir non seulement le Nak-tong-kang,
mais quelques-uns de ses affluents, dont les noms, du
reste, sont presque aussi inconnus que ceux des
localités par où nous allons passer.
Nous
entrons dans la vallée Haing-tong et traversons un
affluent du Nak-tong-kang, le Tong-kang-tchou, qui
coule calme et paisible. De-ci de-là nous rencontrons
quelques nobles mais pauvres Coréens se livrant aux
douceurs de la pêche à la ligne, qu’ils comprennent
d’une façon toute particulière.
Tout
poisson pris est aussitôt dépouillé de ses écailles,
plongé vivant dans une excellente sauce aux haricots
et mangé de suite par notre pêcheur, qui continue
ainsi philosophiquement pendant des heures sa pêche et
son déjeuner.
En
Extrême-Orient
certains poissons sont exquis; j’en ai moi-même mangé
au Japon, et leur agréable souvenir réjouit encore mon
palais.
Nous
passons ensuite par Smo-tang, Oung-ouen-y, Tol-kokai,
Ouen-tchon, Hai-ping, Tchang-thaï, Tchang-nai, Savane,
Mal-sai-tchang-tchang, où nous traversons un second
affluent du Nak-tong-kang, le Tong-kang-soul, qui,
comme tous les fleuves et les rivières de la Corée,
est peu navigable, par suite du manque de profondeur
et des rochers fort dangereux créant des rapides
infranchissables. Aussi la navigation comme transport
de marchandises n’existe pas: seules de légères
barques se livrent à la pêche en effrayant le poisson
pour le forcer à s’enfuir vers des filets préparés à
l’avance. La pêche fluviale, excellente et très
abondante, nourrit une grande partie de la population
coréenne, qui mange indifféremment le poisson frais,
sec ou conservé de toutes autres façons. Nous
rejoignons ensuite un troisième affluent du
Nak-tong-kang, le Tong-kang-kol; cette rivière, comme
presque tous les fleuves et cours d’eau de la Corée,
gèle complètement en hiver. Alors, pour se livrer à la
pêche, on fait dans la glace des trous qu’on entoure
en partie de filets, puis, courant et frappant
partout, on amène ainsi les poissons effrayés vers les
filets qu’on a tendus. La glace atteint toujours une
grande épaisseur, car les maxima de chaleur ou de
froid sont environ de + 35° à - 35°. Aussi en hiver se
sert-on en Corée, particulièrement dans le nord, de
traîneaux et de patins à raquettes, dont les Coréens
sont très fiers, car ils leurs doivent une de leurs
grandes victoires sur les Chinois. Nous quittons la
rivière et passons par Ka-tchang-mou, où, après avoir
franchi la colline Kong-tek-y, Song-tong, de
Tchin-san, nous regagnons enfin le Nak-tong-kang.
Le
fleuve s’étend devant nous, large d’environ 400
mètres, mais sans profondeur. Nous procédons pour le
traverser à l’embarquement de nos chevaux et de nos
bagages sous les yeux de nombreux enfants complètement
nus qui suivent curieusement nos évolutions. J’en
profite pour prendre quelques notes anthropologiques,
que je résume ici brièvement: tous ces garçonnets et
fillettes sont sveltes et admirablement proportionnés.
La tête brachycéphale, de grosseur moyenne, est
légèrement relevée en arrière, et supportée par un cou
très élégant; les cheveux, d’un brun très foncé, ont
des reflets roux; les yeux, noirs et luisants,
étincellent de gaieté; le nez et le menton sont
petits, comme les mains et les pieds, dont les
attaches, très fines, ont une rare distinction; les
bras et les jambes se dessinent dans d’exquises
proportions; tout le corps est admirablement cambré,
la poitrine se projette en avant et les reins ont une
courbe fort gracieuse. L’ensemble de tous ces petits
corps est d’une rare perfection esthétique; il y a là
notamment une petite fille d’une dizaine d’années dont
le corps chaudement coloré par le soleil semble être
une réduction Collas de la Diane de
Houdon.
De
cette étude d’anthropologie infantile il semble
résulter pour nous que les enfants, comme la masse des
classes moyennes, se rapprochent absolument du type
toungouse, fort différent, comme je le montrerai dans
mon ouvrage, du type des hautes classes sociales et de
celui non moins caractéristique des classes infimes.
Après
avoir heureusement opéré notre passage nautique, nous
continuons notre route et atteignons bientôt une série
de collines se dressant à pic de chaque côté du
fleuve, que nous suivons à mi-côté. Tantôt il roule à
nos pieds calme et tranquille, tantôt tumultueux il se
brise à travers les rochers détachés du flanc des
coteaux. La nuit vient, et c’est éclairés par des
torches que nous suivons l’étroit sentier au bas
duquel le moindre faux pas nous précipiterait dans le
fleuve. Heureusement qu’au bout d’une heure de ce
périlleux trajet nous quittons enfin le Mak-tong-kang
pour regagner la plaine et arriver, sous une pluie
d’étincelles, au village où nous devons passer la
nuit.
Le
lendemain et les jours suivants, nous passons
successivement par Morai-tong-y, Tong-hai,
Tchang-na-y, Nam-tchang-mo-ran, De-nai et Kam-tong,
vallée qui nous conduit à Ho-kong-nai et Sarn-thang à
celle de Mam-tong, où nous continuons à parcourir la
plaine circonscrite de collines que j’ai déjà décrite,
pour arriver enfin à la ville Hiran, où nous
remarquons à la sortie un grand nombre de petites
resserres en bois d’un mètre cube, recouvertes de
chaume et supportées par un poteau de deux mètres de
haut. Auprès, une multitude de petits fourneaux
primitifs sont creusés dans la terre est destinés à
l’usage des campagnards, qui, attirés dans cet endroit
par un marché mensuel, ne peuvent, vu leur grand
nombre, loger tous chez leurs voisins et frères en la
grande famille coréenne dont le roi est le père.
Comme
nous marchons lentement, par suite de nos fatigues
précédentes, j’expédie en avant de la caravane un de
mes soldats et un palefrenier pour porter ma carte au
gouverneur de Taïkou en le priant de nous laisser
entrer dans la ville après la fermeture des portes si
nous arrivions en retard.
Hélas!
une heure après, nous rattrapons notre soldat les
habits déchirés; son compagnon, étendu par terre,
semble mort, et quelques Coréens rassemblés autour de
lui cherchent à le ranimer. Voici ce qui s’était
passé: le palefrenier, étant gris a refusé d’obéir au
soldat: de là combat, et notre homme, sachant la
punition sévère que lui vaudra cette révolte contre
l’armée, contrefait maintenant le moribond pour y
échapper. Je lui prends le pouls, et comme il n’a rien
d’anormal, j’ordonne immédiatement la reprise de la
marche de la caravane, à l’approbation générale,
constatant ainsi une fois de plus combien l’autorité
légale est respectée en Corée. Que dis-je? elle est
partout honorée, comme l’attestent les nombreux
monuments élevés par les habitants à l’entrée des
villes et des villages en l’honneur des mandarins qui
se sont signalés par leurs vertus administratives.
Quelques-uns
sont
de véritables petits monuments, avec toitures et
puissants contreforts, formant comme une petite
chapelle ouverte; d’autres sont de simples stèles en
fonte de fer de 60 centimètres sur 20, portant des
caractères en relief. Plusieurs d’entre elles sont
très anciennes et prouvent le haut degré auquel à une
certaine époque les arts métalliques étaient parvenus
en Corée: témoin, du reste, les ruines de tours en fer
dont parle l’ambassadeur chinois dans le récit de son
voyage en Corée, et qui précèdent de tant d’années la
tour Eiffel.
Nous
sommes de plus en plus en retard, par suite de notre
fâcheux incident; aussi, après avoir franchi le
Kornou-kan, affluent du Nak-tong-kang, la nuit nous
surprend, et, le gouverneur n’ayant pu être prévenu,
nous trouvons Taïkou fermé. Il nous faut coucher aux
portes mêmes de la ville, dans une misérable auberge
suburbaine. Ma chambre est bien la plus horrible que
j’aie jamais habitée; un simple détail: les poutres du
plafond disparaissent complètement sous un épais velum
de toiles d’araignées. On me propose de le faire
disparaître; je m’y oppose absolument et préfère
laisser les brunes tisseuses dans leur quiétude,
plutôt que de m’exposer à leur vengeance. Personne
n’insiste, car tous mes hommes sont brisés de fatigue.
Quant aux chevaux, ils sont rendus à ce point qu’à
peine arrivés, ils refusent pour la première fois
toute nourriture et se couchent comme pour mourir. Je
les trouve le lendemain matin dans le même état de
prostration, ainsi que mes compagnons, tant a été
pénible ce voyage, particulièrement au passage des
montages, qui m’atteignent pourtant pas 3 000 mètres.
J’autorise mon monde à rester couché toute la journée
et expédie ma carte officielle au gouverneur. Il
m’envoie aussitôt une garde d’honneur et une lettre
dans laquelle, s’excusant de ce qu’on n’a pas ouvert
les portes la nuit, il m’invite à une réception
solennelle, dans la journée, m’annonce qu’on a préparé
pour moi des appartements au yamen, et m’offre
l’hospitalité. Je fais écrire immédiatement par mon
interprète que je remercie Son Excellence de ses
hautes prévenances, et aurai l’honneur de me rendre à
sa gracieuse invitation pour lui offrir tous mes
hommages. Je signe la missive, la fais porter et me
hâte de sortir de ma valise mon costume de soirée;
hélas! habit, gilet, pantalon, à la suite de divers
bains, ont pris les formes les plus inattendues; il
faut pourtant les mettre, le gouverneur ayant assisté
comme ministre à des réceptions officielles
d’Européens à Séoul. Je me hâte donc de m’habiller,
puis promène autour de mon costume ma glace grande
comme la main et vois avec effarement mon pantalon et
mes manches en tire-bouchon, les pans de mon habit se
fuyant comme deux ennemis irréconciliables;
heureusement mes manchettes et mon plastron de chemise
en celluloïd sont resplendissants. Je compte donc
absolument sur eux pour sauver la situation, et sors
de ma chambre la tête haute, mon claque sous le bras.
Les deux cents personnes présentes manifestent à la
vue de mon étrange costume noir les signes d’une
profonde stupéfaction, qui se change soudain en effroi
lorsque j’ouvre brusquement mon claque pour m’abriter
du soleil; mais, quand je l’ai sur la tête, éclate un
murmure général d’admiration. Car en Corée, pays des
chapeaux, bien qu’on en ait des centaines de modèles,
différents de matière et de forme, jamais, au grand
jamais, on n’avait rien imaginé de semblable au mien.
O Gibus! dors content . . . Je me hâte d’échapper à
l’émerveillement public en m’asseyant dans mon
palanquin officiel; huit hommes vigoureux le soulèvent
aussitôt, et, précédé de mes deux soldats, suivi de
mes serviteurs, entouré de l’escorte du gouverneur, me
voici bientôt dans Taikou, où nul Européen n’a encore
pénétré. Aussi une grande curiosité se
manifeste-t-elle sur mon passage, mais sans le moindre
signe d’hostilité. Nous arrivons ainsi au yamen au
moment même où sort avec sa suite un mandarin de
district dont l’escorte fait entendre le cri guttural
qui établit partout la voie libre sur son passage. Je
pénètre dans la première enceinte du palais, descends
joyeusement de mon palanquin, où mes jambes croisées
sont au supplice, et entre dans l’intérieur du palais;
on me conduit cérémonieusement à la salle d’audience,
réduction de celle du palais de Séoul.
Le
gouverneur, siégeant sur son trône, entouré de toute
sa brillante cour, se lève à mon entrée. Je le salue à
l’européenne, il fait de même, et, après les
compliments d’usage où nous nous
répétons ce que
nous nous sommes dit par lettre, Son Excellence
m’invite à m’asseoir sur les larges coussins qui
m’entourent et à collationner avec lui.
A
peine avons-nous pris place qu’on met devant chacun de
nous quatre petites tables surchargées des mets les
plus étranges. Ils sont servis dans d’élégants vases
en porcelaine, beaucoup plus grand que ceux en usage
en Chine et au Japon. Je ne manque pas, à la façon
orientale, de m’extasier sur la beauté du service, le
parfait assaisonnement du poisson et des viandes
délicieusement apprêtées; puis vient l’éloge des
pâtisseries, des bonbons, des fruits et tout
particulièrement du succulent vin de riz, avec lequel
je bois à Sa Majesté le Roi et à la Corée. Le
gouverneur me répond par un toast à la France. Et
comme décidément le vin de riz est exquis, j’en
hasarde un autre à Son Excellence et à la province
dont il est devenu véritablement le vénéré père. Il
repart à son tour en buvant à la santé de son hôte et
à mon heureux voyage. La collation achevée, un
dialogue plus suivi s’établit entre nous. Mon
interprète, traduisant successivement chacune de nos
phrases, exprime d’abord au gouverneur combien je suis
particulièrement touché de la haute courtoisie avec
laquelle il daigne me recevoir. Il me répond qu’il est
heureux d’accueillir ainsi un homme de haute science,
délégué par le gouvernement français, et l’on me
félicite du voyage que, malgré les circonstances
présentes, j’ai osé entreprendre le premier entre les
Européens.
Humbles
remerciements
de ma part, après lesquels j’expose combien m’ont
frappé la cordialité des habitants du royaume, sa
beauté agreste et surtout son magnifique développement
agricole, qui, sous le rapport de l’irrigation
fécondante des terres, place la Corée à la tête de
tous les peuples de l’Asie.
«Malheureusement
les
saisons ont été contraires cette année, et malgré nos
efforts nous avons, comme vous l’avez vu, un
commencement de famine.
-
Le jour où Votre Excellence le voudra, vous pourrez,
comme en Europe, conjurer ce fléau». Une grande rumeur
d’étonnement se fit parmi les trois cents personnes
qui composent la suite du gouverneur.
«N’avez-vous
donc
pas la famine en Europe?
—Nous
l’avons eue dans les temps anciens, mais nou sommes
sûrs maintenant d’y échapper». Nouveau mouvement de
surprise dans l’entourage.
«Tenez-vous
donc en votre pouvoir et les rayons du soleil et les
nuages du ciel, et les vents qui les dirigent?
—Hélas!
non, Excellence; mais la famine ne peut s’étendre
partout à la fois, et la rapidité de nos moyens de
transport nous permet à peu de frais d’amener où il le
faut la récolte abondante des pays éloignés.
—Je
sais que vous avez chez vous des palanquins immenses
mus par la vapeur, qui transportent tout très
rapidement; mais en passant au milieu de nos terribles
montagnes, vous avez dû juger de l’impossibilité pour
nous d’établir ici de semblables véhicules». Et tout
l’auditoire d’approuver par des murmures flatteurs.
«Je
demande pardon à Votre Excellence de ne pas partager
son opinion, car les multiples obstacles dont elle
vient de me parler seront aisément surmontés le jour
où l’on chargera nos ingénieurs français d’exécuter
les travaux nécessaires».
Stupéfaction
générale.
«Quoi!
la chose est possible?
—Facile;
même si votre vénéré roi et père le veut, on
traversera bientôt tout le pays en quelques heures, en
passant, à son choix, au-dessus ou au-dessous des
montagnes».
Exclamation
d’admiration de tous ceux qui m’entourent.
«Pourtant
je ne dois pas cacher qu’il serait infiniment meilleur
marché de passer par-dessus que par-dessous».
Approbation
générale.
«Nous
étudierons tous la question, car nous savons qu’en
Europe vous êtes les maîtres des sciences.
—Mais
vous pouvez aussi les acquérir.
Et
comme chacun souriait d’un air de doute:
«Faites
comme au Japon, Excellence: envoyez chez nous l’élite
intelligente de votre brillante jeunesse, et elle
rapportera et répandra bientôt ici toutes ces sciences
que vous ignorez, contribuant ainsi à resserrer les
liens d’amitié contractés récemment entre nos deux
pays».
Et
le gouverneur, qui paraît charmé, veut absolument me
retenir au yamen, et met plusieurs chambres à ma
disposition. Je m’excuse près de lui de ne pouvoir
accepter, désireux de partir le lendemain, ne voulant
pas causer dans le palais un tel dérangement. Il
insiste, je persiste en le remerciant mille fois de
son accueil si largement hospitalier; Son Excellence
se lève, l’audience est terminée. Quand je remonte
dans mon palanquin, mon escorte d’honneur est doublée.
Me voici devenu au moins mandarin de première classe!
Nous
faisons dans ce pompeux cortège une longue promenade
dans l’intérieur de la ville, dont je vais décrire le
panorama du haut des murailles. On y monte mon
palanquin pour me faire suivre le chemin de ronde, qui
me rappelle absolument, mais dans de moindre
proportions, l’enceinte de Pékin.
Comme
celle-ci, il forme un immense parallélogramme dallé
encadrant toute la ville. Au milieu de chaque pan se
dresse également une magnifique porte fortifiée,
surmontée d’un pavillon élégant. Il est orné dans
l’intérieur de peintures et de nombreuses inscriptions
rappelant les faits passés. De là j’admire le
Kornou-kan serpentant à travers une merveilleuse
campagne que colorent vivement les tons mordorés de
l’automne; au loin et tout autour de nous se déroule
un cercle de collines à demi fondu dans un ciel
bleuté, qu’illuminent les rayons d’un soleil ardent
dont la chaleur contraste agréablement avec le froid
vif que nous avons enduré dans la chaîne centrale.
A
mes pieds s’étend la grande cité avec ses rues, ses
places et ses monuments; dans les quartiers populaires
les maisons sont couvertes de chaume, mais dans le
centre de la ville, où habite l’aristocratie, se
dressent d’élégantes toitures dont les tuiles à la
bordure et aux arêtes capricieusement relevées,
forment un heureux mélange de lignes droites et
courbes d’une harmonie charmante. Nous admirons dans
le même style deux temples, une vaste école destinée à
l’étude de la langue chinoise, enfin le yamen,
absolument clos, qui contient des bâtiments multiples
au milieu desquels le palais de réception dépasse tous
les autres de son vaste toit polychrome, d’où émerge
au sommet d’un mât l’immense bannière rouge du
gouverneur, flottant dans les airs et dominant la
cité.
Tel
est Taïkou. De retour à l’hôtel des Araignées, je
trouve un délégué de Son Excellence qui me prie de
nouveau en sen nom de me rendre au yamen pour y loger.
J’envoie une lettre d’excuses, et évite ainsi, à tort
peut-être, toutes les exigences de l’étiquette
coréenne pour vivre à ma guise après tant de fatigues.
Je reçois le soir même de nombreux cadeaux du
gouverneur: poulets, œufs, pâtisseries, bonbons, kaki,
etc. Nouvelle carte de remerciements, auxquels on
répond en m’envoyant souhaiter une bonne nuit. Après
avoir adressé les mêmes vœux je peux enfin songer à ma
cavalerie, dont je suis très préoccupé. A ma grande
joie, je retrouve tous nos chevaux debout et
mastiquant de la plus joyeuse façon la fameuse soupe
chaude aux haricots.
Décidément
nous pourrons repartir le lendemain matin de bonne
heure, car ma caravane, qui s’est attachée à moi,
consent à m’accompagner jusqu’à Fousan. Je passe
ensuite la revue de ma garde d’honneur, installée en
grand costume dans la cour, aux portes, un peu
partout, et je rentre dans ma chambre, tout enchanté
de mon séjour à Taikou.
J’avoue
que si la cour de Séoul n’avait pas été en deuil,
j’aurais, malgré les obligations de cour, accepté
l’hospitalité du gouverneur, pour profiter de toutes
les réjouissances qu’en temps ordinaire on m’eût
probablement offertes. Elles se composent généralement
d’un concert coréen, d’exercices acrobatiques, de
danses exécutées par des jeunes filles ou femmes
élevées dans ce but, enfin d’une représentation
théâtrale. Pour ne pas priver le lecteur de toutes ces
distractions, j’en donne ici quelques croquis et vais
les compléter par l’aimable récit d’une fête de ce
genre traduit sommairement d’un très intéressant
volume sur la ville de Séoul, publié à Boston chez
Ticknor and Company sous le titre de Choson, the land
of the morning calm, par M. Percival Lowell,
secrétaire de la légation des États-Unis en Corée.
Le
très spirituel auteur raconte que, pendant son séjour
à Séoul, il organisa avec plusieurs collègues
européens une partie de campagne au couvent le plus
proche pour y faire un petite fête à la façon des
Coréens de distinction.
«On
part de grand matin, accompagné de domestiques chargés
de tout ce qu’il nous faut pour vivre à l’européenne,
de quelques geisha,
musiciens et comédiens coréens, enfin des chevaux
nécessaires à l’expédition. Nous traversons
joyeusement une partie de la charmante campagne qui
environne Séoul et faisons l’ascension de la montagne
où se trouve le couvent. Il contient, outre
d’importantes dépendances, deux pagodes peu
remarquables. Au moment de notre arrivée on sonne les
cloches à la façon chinoise, c’est-à-dire en faisant
retomber bruyamment le marteau sur la cloche immobile.
Enfin trois coups largement espacés indiquent que l’on
commence l’office dans les temples.
«Nous
pénétrons dans le principal, qui contient des images,
des tambours, des fleurs artificieles, des bâtons
d’encens bizarres et un immense poisson en bois
suspendu au plafond. Au moment où nous entrons, douze
moines en habits solennels marchent en procession et
forment en chantant une spirale sans fin, pendant
qu’un novice accroupi près de l’autel bat le tambour.
La litanie est en sanscrit, langue que ces pauvres
moines ignorent, ce qui excuse leurs sourires quand
ils passent près de nous. La cérémonie se termine
bientôt par l’offrande habituelle à l’autel de riz, de
fruits et enfin de la fleur de lotus. Nous sortons
pour gagner le réfectoire, où nous dînons servis par
les aimables geisha, qui, comme des gazelles, se sont
peu à peu apprivoisées à nous. Flagrante Iris
même murmure doucement à mon oreille les quelques mots
japonais qu’elle connaît sous l’impression touchante
mais erronée qu’ils sont le langage de son cœur. Sa
charmante coquetterie forme contraste avec les figures
des moines, qui nous regardent avec étonnement et sans
rien dire. Elle est vraiment charmante, cette jeune
fille: j’oublie déjà dans son sourire que je suis
étranger et à deux milles lieues de ma patrie quand on
nous prie après le dîner de quitter nos places afin de
disposer la salle pour la représentation. En un
instant on nous installe à l’extrémité de la vaste
salle sur des nattes, coussins, etc.; devant nous les
musiciens s’assoient en cercle et préparent leurs
instruments; plus tard ils seront acteurs, cumulant
ainsi deux professions. Une foule compacte les
entoure, on dirait une mer de figures humaines;
chacune d’elles exprime l’émotion, la curiosité,
l’attente et le contentement. Les plus éloignés se
tiennent debout contre le mur, car la salle est
remplie et les portes elles-mêmes sont encombrées de
spectateurs curieux. Ils sont bizarrement éclairés par
trois grandes lanternes polychromes qui projettent
leurs rayons à travers une atmosphère chargée de fumée
de tabac, donnant une couleur spéciale à ce tableau si
étrange. Dans le fond de la pièce, les moines
bouddhistes, avec leurs têtes rasées, leurs soutanes
couleur marron, leurs ceintures de chanvre, leurs
rosaires, leur chapelets placés autour du cou ou
suspendus à leurs ceintures, etc., regardent avec
étonnement et la plus grande attention. Les novices
aux jeunes figures rayonnantes d’admiration,
contemplent avidement la scène, oubliant ce qu’ils
sont et où ils sont. Nos propres serviteurs sont mêlés
avec eux; leurs vêtements de diverses nuances et leurs
chapeaux de feutre noir forment un contraste étrange
avec le simple costume des moines. Dans cette foule
compacte et mélangée, la curiosité fait oublier le
rang: nul ne céderait sa place, pas plus les
domestiques, ayant toujours en Corée le privilège de
tout voir, que ces excellents moines, qui, malgré leur
profession, tiennent absolument à assister au
spectacle.
«Il
commence enfin. Les exécutants nous font d’abord de la
musique, ils tirent de leurs instruments habituels les
sons les plus discordants; l’ensemble n’existe pas;
flageolets, flûtes et violons à deux cordes ne
s’entendent que pour marcher à contre-mesure; seuls
tambours, cymbales et gongs, en raison de leur ton
neutre, s’harmonisent avec tout le monde.
«Le
concert cesse, on nous sert le thé, puis vient la
rcprésentation dramatique.
«Le
théâtre en Corée est composé uniquement de scènes
caractéristiques. Elles forment presque toujours un
monologue débité par un seul acteur, bien qu’un ou
deux autres lui prêtent quelquefois leur assistance,
mais ce sont des ombres servant à mettre l’étoile
mieux en évidence. Il n’y a ni scène, ni décors:
l’acteur est là devant nous avec le costume qu’il a pu
improviser pour répondre à ses besoins: un peu plus ou
un peu moins de vêtements, c’est tout. Il saisit
habilement quelques traits de mœurs ou usages coréens
et les présente très bien sous leur côté comique;
étrangers et natifs, nous sommes tous enchantés. Par
exemple c’est un paysan tâchant d’obtenir une entrevue
avec un noble pour lui présenter une requête qu’il
doit faire depuis longtemps. Il emploie tous les
artifices possibles pour persuader au garde de le
laisser entrer; c’est un mélange d’effronterie, de
cajolerie à émouvoir tout le monde, excepté un chien
de garde. A la fin le cerbère se laisse persuader et
le rustique se trouve alors en présence du grand
personnage. Il redevient tout à coup aussi respectueux
que vous pouvez le désirer. Simple mais éloquent, on
trouve en lui un modèle de la plus parfaite servilité,
c’est évidemment un homme qui sait ce qu’il veut et
l’obtiendra. Tout ceci est représenté par l’artiste
sans aucun accessoire, car il n’a pas même devant lui
le noble imaginaire auquel il parle; tout repose donc
uniquement sur son talent.
«Nous
avons devant nous un artiste des plus remarquables, Le
voici qui se montre sous la forme d’un faux aveugle,
essayant, sous ce déguisement, de traverser Séoul la
nuit, en dépit de la loi du couvre-feu. La patrouille
arrive, il la trompe par toutes les maladresses de sa
prétendue cécité, à la grande joie de l’auditoire,
dont plus d’un a lui-même posé à son profit le rôle
d’aveugle clair-voyant. Voici maintenant la tragédie.
Un voyageur isolé se trouve face à face dans la
montagne avec un tigre. Sa mimique terrifiée nous
donne la chair de poule; et quand tout à coup, devenu
tigre lui-même, il pousse de rauques et formidables
miaulements, notre sang se glace dans les veines, nous
frémissons tous instinctivement. Le spectacle se
termine gaiement par les embarras d’un marchand de
tabac qui forme peut-être la meilleure partie de la
représentation. Le pauvre diable tâche de vendre sa
marchandise et ne réussit pas du tout; il a presque
persuadé quelqu’un contre sa propre volonté, lorsqu’un
malentendu survient; enfin, le voici mêlé à une
dispute, et quelque peu battu; alors, frictionnant ses
membres meurtris, il s’assied navré et recommence son
inimitable cri de: «Tabac à vendre!» qui sépare
chacune des scènes de la façon la plus comique. Aussi,
en rentrant dans nos cellules, répétons-nous tous avec
la voix et le geste automatique de l’artiste: «Tabac,
tabac à vendre! ».
Le
lendemain, échange avec le gouverneur de plusieurs
cartes, où nous nous faisons mutuellement, d’après les
rites, une foule de politesses matinales. Je lui
adresse enfin une lettre d’adieux exprimant tous mes
remerciements de son gracieux accueil. En retour, il
me souhaite un bon voyage, met à ma disposition sa
magnifique escorte et m’annonce qu’un déjeuner m’est
préparé par ses soins à la prochaine station. On ne
peut être plus aimable, et, tout en étant très
reconnaissant des princières prévenances de Son
Excellence, je les attribue moins à moi-même qu’à la
France, qu’il a voulu honorer dans son modeste
représentant scientifique. Mais, au point de vue de
l’exquise politesse coréenne, je dois ajouter que
l’aimable gouverneur et le ministre des affaires
étrangères, en réponse à des souvenirs que je leur ai
adressés de Paris pour les services que tous deux
m’avaient rendus, m’envoyèrent chacun avec une grâce
parfaite de fort jolis cadeaux et de charmantes
lettres. Voici la traduction de l’une d’elles, très
curieux spécimen du style épistolaire coréen.
«Réponse
de M. Kirn-Kiang-Tchin, gouverneur de la province de
Kyeung-Sang, à M. Collin de Plancy, le 4 du deuxième
mois de l’année Keuctchouk (le 26 décembre 1889).
«L’année
dernière,
M. Varat, qui était en train d’accomplir son voyage
autour du monde, m’a fait l’insigne honneur de passer
par ma capitale; nous avons conversé longuement
ensemble et sommes devenus amis dès notre première
entrevue; cette visite m’a causé tellement de plaisir
que je ne l’ai point oubliée jusqu’à ce jour.
«Maintenant
l’aimable explorateur veut bien me faire cadeau de
deux tapis: ce présent vient du fond du cœur, et est
tellement précieux pour moi que je ne puis m’empêcher
de l’avoir conti-nuellement sous les yeux.
«La
politesse rend bienfait pour bienfait: j’ai donc
choisi quatre stores en bambou très fin que je suis
heureux d’offrir à M. Varat.
«J’espère
que Votre Excellence voudra bien faire parvenir ces
objets au destinataire et lui transmettre l’expression
de toute ma gratitude.
«(Je
termine cette lettre) en remerciant également Votre
Excellence des compliments qu’Elle a bien voulu
m’adresser et des éloges dont Elle m’a comblé».
Hélas! j’ai le
regret de cons ta ter ici que, l’année suivante,
j’apprenais non seulement la mort de cet aimable
gouverneur, mais aussi celle de Mgr Blanc et de la
sœur venue du Sénégal qui m’avaient si gra-cieusement
accueilli à Séoul.
Je
reprends mon veston de voyage, et me mets cette fois à
la tête de la caravane, c’est-à-dire à la place
officielle déterminée par les rites, car j’ai
maintenant un cortège des plus pompeux. Une centaine
de serviteurs du gouverneur m’accompagnent dans leurs
brillants costumes, dont les plus riches sont en soie
claire, bleue, rose ou verte, recouverts de gaze noire
ou blanche. Tout cela resplendit sous les gais rayons
du soleil matinal et nos petits chevaux sont comme
affolés au milieu de ce luxe de vêtements aux riches
couleurs, auxquelles leurs yeux ne sont pas
accoutumés. C’est ainsi que nous traversons
majestueusement la ville, au milieu d’une nombreuse
population accourue de toutes parts pour assister à
notre départ. Nous gagnons la campagne, et, quelques
kilomètres plus loin, comme nous descendons une côte
en cette superbe ordonnance, voilà que tout à coup
retentit dans les airs une épouvantable fanfare, si
inattendue, stridente et fantastique, qu’on se
croirait au jugement dernier. Nos chevaux terrifiés se
cabrent; mes quatre cavaliers tombent, et l’un d’eux
si malheureusement que, le pied pris dans son étrier,
il est entraîné par sa monture. Un effarement général
se produit dans ma vaillante escorte. Je lance mon
cheval pour rejoindre mon soldat en détresse, et au
moment où, penché à demi, je vais le sauver, ma selle
tourne, et me voilà par terre à mon tour, prouvant une
fois de plus combien la roche Tarpéienne est près du
Capitole. Je ne me suis fait aucun mal, me relève
aussitôt, crie et fais signe à mes gens affolés
d’arrêter les poneys; ils s’en rendent enfin maîtres
et je constate avec plaisir que personne n’est blessé.
Alors, pour sauvegarder ma dignité atteinte par ma
chute, je passe mon bras entre la sangle et le ventre
du cheval pour montrer devant tous, au palefrenier,
que, ahuri de notre brillant cortège, il a oublié de
sangler ma bête. Après les reproches obligatoires,
j’imagine, pour relever complètement mon prestige, de
me faire voir de mon poney, qui, à l’aspect de mon
costume, auquel il ne peut s’habituer, se dresse sur
ses jambes de derrière, et veut recommencer, mais en
vain, car cette fois je me suis mis en selle à
l’émerveillement des Coréens. Ceux-ci sont, en effet,
de très médiocres cavaliers particulièrement les
personnages officiels, qui ne montent jamais
qu’accompagnés de quatre palefreniers tenant chacun
une des longues lanières attachées par paire au mors
et à la queue de l’animal dont ils dirigent ou
arrêtent ainsi le moindre mouvement. Le mandarin ainsi
monté n’a donc qu’à se prélasser confortablement dans
la plus douce quiétude.
La
caravane se reforme, et mon interprète me demande s’il
faut interdire les fameuses sonneries.
«Sont-elles
d’usage?
—Oui,
me répond-on.
—Alors
que les sonneurs, au lieu de se tenir à l’arrière de
la caravane, passent en avant, et musiquent selon les
rites».
En
effet, il n’y a plus rien à craindre ainsi, car les
trompettes, cause de notre accident, se composent de
trois parties qui ressortent les unes des autres, et
atteignent avec leur entier développement plus de l m.
20 de longueur, de sorte que, placées devant nous,
nous avons le temps, en les voyant s’allonger, de
rassembler les rênes et de maintenir nos chevaux. Nous
arrivons ainsi avec toute la pompe et l’ harmonie
désirables au village, où nous profitons du magnifique
déjeuner de Son Excellence; puis ma superbe escorte
reçoit une dernière carte pour le gouverneur et
s’éloigne en me remerciant de mes largesses; elle
rentra le soir même au yarnen.
Nous
reprenons maintenant notre ordre de marche accoutumé
dans la direction sud-est, à travers un paysage
semblable à celui que j’ai décrit avant d’arriver à
Taïkou.
Nous
rencontrons en route un jeune orphelin d’une douzaine
d’années absolument sans ressources dans ce pays où
commence à sévir la famine: nous le prenons donc pour
remplacer le palefrenier qui s’est révolté. Comme il a
une petite figure intéressante et est doué d’une
grande activité, je le charge désormais du soin de mon
cheval.
Bientôt
nous traversons de vastes terrains sablonneux formant
parfois de petits coteaux, sur lesquels l’eau de pluie
a fait de fortes érosions. Là, comme partout, grâce à
une savante irrigation, on a su rendre productifs ces
terrains autrefois stériles, et l’on y cultive fèves,
haricots et divers légumes, toutes sortes de fruits,
particulièrement le kaki, des bois précieux, enfin le
mûrier, qui a amené partout l’élevage du ver à soie.
Après
avoir traversé le Tcha-kine-oune-san par un col assez
élevé, nous arrivons à la chute du jour devant la
ville de Tchangto aux murailles crénelées. La double
porte fortifiée est toute grande ouverte, mais, à ma
vive surprise, nous ne voyons ni gardien, ni passants,
ni marchands, gens qu’on rencontre généralement en ces
sortes de lieux. Nous pénétrons dans la cité: même
solitude, même silence, l’herbe pousse dans les rues,
et, malgré le bruit que fait la caravane, nul
n’accourt à notre passage, aucune porte ne s’ouvre
pour nous voir, c’est pis que le château de la Belle
au bois dormant, où l’on apercevait du moins les
assoupis. Ici, rien, pas même une ombre humaine, et
j’aurais cru la ville inhabitée si nous n’avions
rencontré un ou deux chiens errants et vu, au milieu
de la brume du soir, je ne sais quelle lumière opaque
à travers les châssis en papier de quelques rares
fenêtres. Nous sortons par la porte opposée à celle où
nous sommes entrés, et restons longtemps muets, comme
si le silence de la ville eût été contagieux. Je me
retourne pour jeter un dernier regard sur cette
étrange cité, et vois les lourdes portes se fermer
doucement seules, comme si elles eussent été poussées
par les esprits des morts. J’apprends au prochain
village, où nous passons la nuit, qu’à la suite d’une
épouvantable épidémie de choléra la ville a été
presque complè-tement abandonnée. Ce terrible fléau
décime fréquemment tout le pays.
Nous
avons vu comment les Coréens cherchent à désarmer
l’esprit de la petite vérole, ils emploient un système
à peu près analogue pour toutes les maladies: il
consiste à garnir de nourriture une petite table
rectangulaire destinée à cet usage; deux vases de
fleurs sont placés à chaque extrémité, et un tambour
est suspendu au-dessus, alors le mari et la femme qui
ont quelqu’un des leurs malades s’assoient à terre
devant la table et appellent l’esprit de la maladie en
frappant sur le tambour et en agitant une sonnette
pour l’inviter au repas ainsi offert et détourner par
là sa colère; mais pour agir sur l’esprit du choléra,
le procédé est tout à fait particulier et même
préventif: il consiste simplement à fixer à sa porte
une peinture représentant un chat; en voici la raison,
ultra-logique: La morsure du rat donne des crampes, le
choléra également. Que craint le rat? Le chat. Donc il
en sera de même pour le choléra C.Q.F.D, si je me
rappelle mes mathématiques.
Le
lendemain, pour la première fois, le temps est
véritablement couvert et je dois insister pour faire
partir la caravane; mais, une embellie étant survenue,
mes hommes recouvrent leur gaieté, et l’un d’eux
m’apporte mon bouquet matinal. Voici comment cet usage
s’était introduit. J’ai pour principe en exploration,
comme je l’ai déjà dit, de me montrer au départ très
exigeant pour tout ce qui regarde la discipline du
convoi, certain que chacun se soumettra aisément, se
sentant près de l’autorité; et comme les bonnes
habitudes sont bientôt prises, on n’a plus après qu’à
se montrer plein de bonté pour tous. Aussi mes hommes,
enchantés de moi, s’ingénient-ils chaque jour pour
répondre aux soins que je prends d’eux, de leurs
chevaux. C’est ainsi qu’un après-midi, j’ai fait signe
à un des palefreniers de me cueillir une fleur
inconnue, et, après l’avoir admirée, pour ne pas faire
fi de la pauvrette, je l’ai mise à ma boutonnière; à
partir de ce moment, chaque matin on m’offre un petit
bouquet, que je fixe de la même façon à mon vêtement.
Donc,
lecteur, si jamais vous faites de l’exploration et que
vous vouliez être adoré de vos compagnons, faites
comme moi et vous serez fleuri tous les jours par une
Isabelle en pantalon.
Nouvelle
ascension
du Tcha-kine-oune-san, qui, après avoir fait un
demi-cercle, se présente maintenant à nous sous
l’aspect d’une simple colline.
La
pluie qui nous menace depuis le matin tombe enfin,
aussitôt je mets mon caoutchouc, et tous mes hommes
s’enveloppent dans d’énormes manteaux en papier huilé
qui couvrent entièrement le corps, pendant que la tête
disparaît sous un vaste bonnet triangulaire de même
matière. Ces papiers, avant de devenir manteaux de
pauvres diables, ont joué un rôle beaucoup plus
glorieux, car, aux caractères chinois dont ils sont
recouverts, mon interprète reconnaît que ce sont des
feuilles de concours d’aspirants lettrés. Rien de
curieux comme de voir ainsi se promener à travers la
campagne ces vénérables thèses ambulantes. S’il est
une chose au monde que le Coréen déteste, c’est la
pluie. Quand un grain parfois nous surprend, tous mes
gens demandent à s’arrêter au prochain village; j’ai
beau, en plaisantant, les appeler poules mouillées,
eux habituellement si gais, gardent l’air le plus
navré. Cela tient non seulement à la misérable
chaussure de paille qui protège très imparfaitement
leurs pieds, mais surtout à une coutume religieuse
relative aux prières publiques qu’on fait pour obtenir
l’eau du ciel. Le mandarin, chargé de la demander au
nom de la population, doit, s’il est exaucé, rester
lui-même à la pluie jusqu’à la chute du jour, et nos
hommes, en la recevant stoïquement, craignaient qu’on
ne crût là-haut à leur désir d’être ainsi mouillés à
perpétuité.
Aussi
ce jour-là, après avoir marché plus de deux heures
sous une pluie battante, je cède enfin à la demande
réitérée de tous et m’arrête à Mil-yang, que nous
apercevons brusquement ainsi que le fleuve. La ville
sélève.en amphithéâtre sur une colline, chose
exceptionnelle en Corée, car nous avons vu qu’on
habite géné-ralernent au bas des coteaux, survivance
probable de quelque ancienne coutume, dont il y aurait
lieu de rechercher l’origine. Cette antique cité se
présente à nous sous l’aspect le plus pittoresque. Au
sommet de la colline s’élève son yamen en ruines, dont
il ne reste que l’élégante et superbe toiture,
soutenue par de gigantesques colonnes entre lesquelles
on aperçoit le ciel. Deux ou trois temples et quelques
édifices publics couverts de tuiles multicolores
surgissent au milieu de nombreux toits de chaume,
au-dessous desquels se dressent les remparts à demi
détruits et recouverts de mousse. Ils dominent une
plaine magnifique, où de-ci de-là croissent
pittoresquement des bouquets d’arbres de toutes
sortes, autour desquels, grâce à un regain de verdure,
brillent mille fleurs des champs; le fleuve la
sillonne paresseusement de ses eaux endormies au
reflet d’un blanc métallique. L’intérieur de la
vieille cité est du plus curieux intérêt
archéologique: ses rues, ses monuments et même ses
maisons, particulièrement celles des nobles, la
plupart en ruines, ont un caractère personnel dans
leurs grandes lignes; leurs délicates et capricieuses
sculptures prouvent qu’il y a eu ici un véritable art
architectural natif cherchant à se dégager des
influences chinoises.
Plusieurs
époques
artistiques y sont représentées d’une si heureuse
façon que Mil-yang est pour moi comme le Nuremberg de
la Corée.